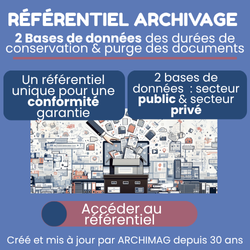L'école vient de prendre possession de ses nouveaux locaux au coeur de Paris. L'occasion de faire le point sur son enseignement et l'évolution de la discipline archivistique.
Après plus d'un siècle passé dans le Quartier Latin, l'École des chartes a quitté la rive gauche au mois d'octobre dernier pour s'établir au cœur du deuxième arrondissement de Paris. Cette installation dans le « quadrilatère Richelieu » ne doit rien au hasard. Le quartier est en passe de devenir le coeur battant du patrimoine français. Plusieurs institutions y ont déjà élu domicile : la Bibliothèque nationale de France, l'Institut national de l'histoire de l'art, et l'Institut national du patrimoine. À quelques encablures, on trouve également le ministère de la Culture et l'École du Louvre. « Nous nous sommes éloignés des universités, mais nous nous sommes rapprochés d'institutions dédiées au patrimoine et, surtout, nous allons tripler notre surface », souligne Jean-Michel Leniaud, directeur de l'École nationale des chartes (ENC).
La vénérable école (fondée en 1821) bénéficie désormais d'une surface utile de 1 660 m² dans un immeuble de 1930 restructuré par l'agence Akpa. Sur près de dix étages, les élèves et les enseignants disposent d'espaces particulièrement élégants : bois clair, mobilier épuré, dispositifs de lumière indirecte, terrasse... Un puits de lumière en forme de colonne traverse les étages. Sur son fuselage, une longue citation latine que peuvent méditer les élèves : « Il convient de confier les événements aux traits de l'écriture afin de les transmettre en perpétuelle mémoire »...
Multiplication des stages
Le déménagement rue de Richelieu est également l'occasion pour l'ENC de revenir sur les nouveautés introduites dans son fonctionnement. Une nouvelle chaire d'archéologie a fait son apparition et la chaire d'histoire du livre et des médias à l'époque contemporaine s'est ouverte au cinéma et au traitement de ses archives. « Nous avons également décidé d'allonger la scolarité de 3 ans à 3 ans et 9 mois pour les élèves fonctionnaires afin qu'ils multiplient les stages en France et à l'étranger. Quant aux étudiants en master, ils bénéficient d'une meilleure articulation entre la première et la deuxième année », explique Jean-Michel Leniaud.
En revanche, le concours d'entrée est toujours aussi redoutable. Les candidats ont récemment planché sur les sujets suivants : « le conflit d'autorité dans l'Église : pape et concile du début du pontificat de Boniface VIII à la fin du concile de Bâle », « dissertation à partir d'une citation d'Italo Calvino, Pourquoi lire les classiques »... Sans oublier les versions latine, grecque ou allemande.
Ces sujets confirment-ils la réputation d'école conservatrice ? Jean-Michel Leniaud répond d'un revers de la main : « On s'en fiche un peu ! C'est une critique un peu facile, car nous formons en effet des conservateurs. En réalité, nous évoluons à la mesure des transformations du contexte professionnel : exploitation des sources nativement numériques, traitement des archives contemporaines, numérisation... Qui sait, par exemple, que ce sont des chartistes qui s'occupent du dépôt légal du web au sein de la Bibliothèque nationale de France ? À l'École des chartes, nous ne formons pas des clones ! Les élèves sont tous différents les uns des autres ». Récemment, un élève s'est même positionné sur le secteur des jeux vidéo.
Un taux d'insertion professionnelle de 95 %
Pour autant, les effectifs de l'ENC restent modestes : autour de vingt élèves pour chacune des trois années des élèves fonctionnaires ; des valeurs semblables pour la filière master. Au total, l'école comptait 150 élèves en 2013. Depuis une quinzaine d'années, ces chiffres subissent une baisse régulière. Mais l'école peut se prévaloir d'un taux d'insertion professionnelle de 95 %.
En ce début d'année 2015, l'École des chartes porte son regard au-delà du périphérique. Le Comité des travaux historiques et scientifiques, rattaché à l'école, rejoindra le campus Condorcet qui ouvrira ses portes à Aubervilliers (Seine Saint-Denis) à l'horizon 2018-2019. Et depuis trois ans, des élèves sont envoyés en stage à Saint-Denis pour procéder à des fouilles archéologiques et au traitement des archives de l'abbaye.
D'autres chantiers sont en cours : le site web de l'école sera refondu au mois de mars prochain et la bibliothèque de 150 000 volumes, toujours sise à La Sorbonne, devrait rejoindre le Quadrilatère Richelieu en 2016.