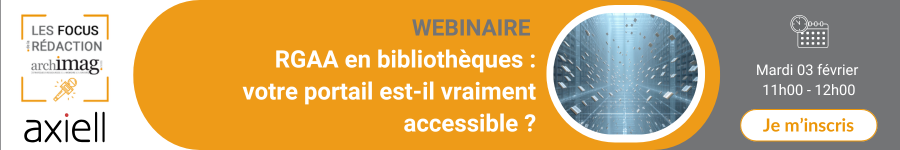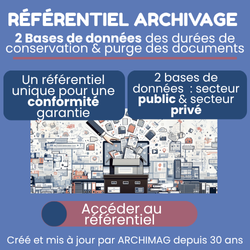Valoriser un site historique ou remarquable ? Des oeuvres d’art ? Des archives… ? Selon l’objet patrimonial, la tâche de valorisation n’est pas identique. Cependant, des lignes directrices communes apportent des repères.
Aujourd’hui, il est acquis que valoriser un patrimoine est un projet scientifique et culturel.
Valorisation physique
La première direction qui peut être suivie est la valorisation physique, en particulier dans le cadre d’une exposition permanente ou temporaire, éventuellement aidée de dispositifs numériques.
Une exposition délivre un message détaillé dans un scénario où l’objet est positionné.
Attention à la fragilité de l’objet. Il faut veiller aux conditions de température et d’humidité, évaluer les risques de sinistre et prévoir un plan d’évacuation. Le mobilier doit être adapté, de même que l’éclairage. Par exemple, pour une collection d’archives, de dessins, de photographies, on préférera une ambiance de pénombre propre à la conservation.
L’objet est accompagné de panneaux descriptifs ou explicatifs, de vidéoprojections de textes (« scriptovisuels »), de dispositifs multimédias (bornes interactives, tablettes, audioguides).
Valorisation numérique
La seconde direction pour la valorisation est la numérisation. Les musées s’y sont mis dès les années 1990.
Ses coûts en moyens humains, financiers et techniques sont à considérer (voir encadré).
Elle permet au préalable de mettre en place un inventaire numérique, véritable outil de gestion.
Surtout, elle ouvre la voie de la valorisation virtuelle. L’objet, de fait moins soumis aux manipulations, est accessible à distance. Un portail en autorise la consultation, le met en scène dans une visite ou une exposition virtuelles.
Qui dit valorisation dit évaluation : on se penchera sur les chiffres de fréquentation physique ou virtuelle, on pourra aussi lancer des enquêtes.
Mais rien n’est possible sans une politique de préservation et restauration.
Archives, bibliothèques, musées, archéologie et monuments historiques : les interventions en ce sens, pour les domaines relevant du Code du patrimoine, sont soumises au contrôle scientifique et technique de l’Etat. Des chartes et recommandations internationales peuvent être à respecter.
La démarche de préservation commence par l’élaboration d’un projet. Suivent une déclaration de travaux et la recherche et sélection de professionnels.
La décision de restaurer ne va pas de soi, mais s’impose quand un processus de dégradation est entamé. Le diagnostic suppose d’examiner l’objet, de dresser un bilan sanitaire, de rechercher les causes des altérations et d’en prédire les évolutions.
On recherche un équilibre entre sauvegarder l’objet et entretenir son originalité. On veut entretenir une mémoire. Pour les grottes de Lascaux, on a choisi de reconstruire (Lascaux I, II, III, IV).
Solutions de numérisation
Différentes sociétés proposent des solutions et prestations en numérisation à vocation patrimoniale. Citons notamment : 4DigitalBooks, Archimaine, Arkhênum, AureXus, Azentis Technology, Centre Direct du Multimédia, Numen, Numerize, ProGEDoc, United Music Foundation, Xelians…
Pour sélectionner son prestataire, on évaluera bien sûr sa capacité à traiter les objets à lui soumettre et donc son parc technique. Du livre ancien au tableau d’art, en passant par des microfilms ou des fonds vidéo, tout peut être pris en charge. Une numérisation à 360° ou en 3D est même possible. Le service peut éventuellement être rendu sur place.
Format et qualité de numérisation, support de restitution (ou hébergement de fichiers) sont à définir.
L’engagement du prestataire à respecter des normes et standards (Iso 19264, FADGI…) est un atout.
Impossible d’avancer un coût moyen pour une numérisation à vocation patrimoniale. La discussion d’un devis est nécessaire.
>>> Vous souhaitez en savoir plus ? Téléchargez gratuitement le Supplément d'Archimag "Valorisez votre patrimoine : il y a urgence" en cliquant ici !