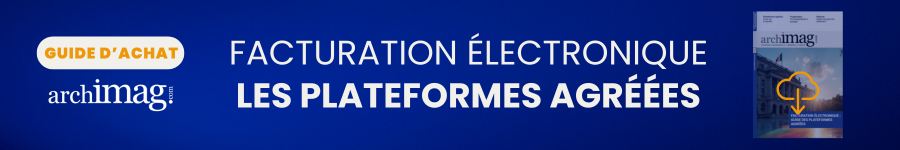Julien Pierre est co-auteur avec Camille Alloing de l'ouvrage "Le web affectif, une économie numérique des émotions" (Ina, collection "Etudes et Controverses", 2017).
Qu'est-ce que le web affectif ?
Le web affectif est une façon de penser ce qui se joue sur le web actuellement. Nous identifions comme stratégies affectives le déploiement de ressources visant à faire circuler en ligne ce qui nous affecte, ou ce qui pourrait affecter nos audiences. Ainsi, on note une augmentation de plus en plus vive de l’invitation à partager nos expériences, ou à vivre des expériences de plus en plus intenses.
Au final, converge une somme d’injonctions à se connaître, à connaître ses émotions, à faire preuve d’empathie vis-à-vis des autres, à vivre pleinement pour soi et pour les autres : c’est une promesse, aussi vertueuse qu’elle soit, qui transforme nos émotions en véritable compétence socio-professionnelle. Cela s’inscrit donc dans une logique de performance, qui peut conduire à de l’épuisement.
Les grands acteurs du numérique exploitent-ils nos émotions pour accroître leurs profits ?
Oui. En tous cas ils essayent. Les investissements en recherche et développement sont à la hauteur des ambitions. Les discours énoncés par les ingénieurs, développeurs, fondateurs des grandes plateformes montrent comment ils considèrent nos réactions émotionnelles : l’ultime levier économique capable d’optimiser toute relation-client.
Toutefois, le socle technologique employé est très bancal : les fonctionnalités affectives reposent sur l’identification de cinq émotions (joie, tristesse, colère, dégoût, peur). Or, notre spectre affectif est bien plus large : l’émotion est instantanée, physiologique, tandis que nos sentiments sont conscientisés, culturalisés, nos humeurs durent plusieurs jours, notre caractère nous accompagne toute notre vie ou presque. Et cette richesse n’est pas du tout mesurée par les technologies. Pour l’instant.
Les internautes doivent-ils s'interroger avant de liker, partager ou cliquer sur un émoji ?
Ils le font déjà. Nous ne sommes pas dans le registre de la pulsion : il y a dans l’usage du like ou du clic une véritable réflexion qui s’opère, parfois des stratégies. Chacun a éprouvé le fait qu’une communication est sujette à interprétation, voire à mésinterprétation. On perd en ligne ce qu’on arrive à lire dans le face-à-face, mais on retrouve, par exemple avec les émoticônes, des signes de modération.
Toute cette ironie, ce second degré n’est pas accessible par les technologies (pour l’instant). De même, nous n’avons pas accès au traitement réalisé par la technologie, ni au commerce réalisé par les acteurs économiques. Une éducation à l’affectivité en contexte numérique aurait toute sa place dans les réflexions actuelles autour de l’éducation aux médias et à l’information.