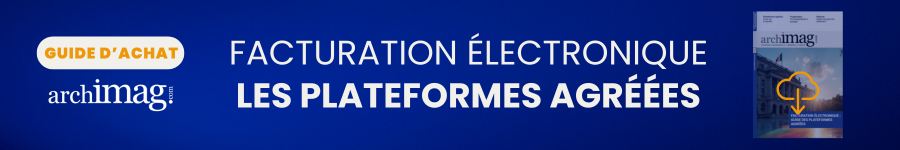Bonne nouvelle : 73 % des scientifiques se disent favorables à la mise à disposition des données de recherche en libre accès. Mauvais nouvelle : 65 % d'entre eux n’ont jamais été récompensés de quelque manière que ce soit pour avoir partagé leurs données. Ce constat mi-figue, mi-raisin est résumé d'une formule lapidaire : "l'un des principaux obstacles au partage des données est le manque de reconnaissance et de valorisation".
Selon le rapport annuel sur le statut des données ouvertes, publié par Figshare, Digital Science et Springer Nature, le partage des données est largement accepté par les 4 200 chercheurs interrogés à l'échelle mondiale. Mais cet engouement est vite tempéré par les réalités du terrain : "les personnes interrogées nous ont très clairement signalé qu’il y a un manque de reconnaissance pour le partage de données" explique Mark Hahnel, PDG et fondateur de Figshare ; "les chercheurs et chercheuses veulent partager leurs données avec d’autres, mais le système actuel manque d'incitations et ils ont besoin d'aide pour mieux comprendre les licences et les droits d'auteur."
Principes de données FAIR
Malgré la mise en place des principes de données FAIR (faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables), la communauté scientifique fait valoir ses doutes et demande une plus grande reconnaissance dans leur engagement en faveur des données ouvertes. Pour Mark Hahnel, "il sera certes utile de fournir une formation et un soutien, mais ce n’est qu’en améliorant la façon dont les universitaires sont récompensés que nous pourrons évoluer vers un monde où les données seront partagées plus ouvertement."