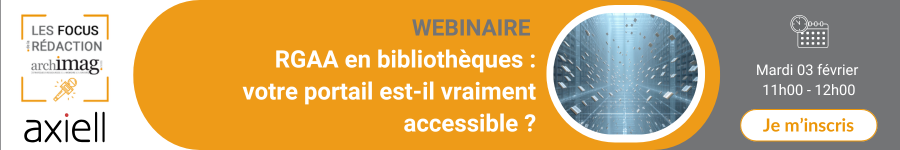Dans un rapport remis au gouvernement, la députée Paula Forteza plaide pour un rapprochement entre chercheurs et entreprises et le développement de formations dédiées à l'ingénierie quantique.
A l'heure où l'informatique quantique s'invite dans les débats, le rapport de la députée Paula Forteza était attendu par les acteurs de la filière numérique. Tous les constructeurs se penchent en effet sur les calculateurs quantiques qui devraient bouleverser les outils numériques professionnels mais aussi personnels dans les années à venir. Selon certains observateurs, l'informatique quantique aura des effets comparables à l'invention du transistor au milieu du XXème siècle. Elle sera en mesure de résoudre des problèmes habituellement inaccessibles aux ordinateurs que nous connaissons aujourd'hui.
Bonne nouvelle : "La France a la chance d’être dotée d’un écosystème d’une immense qualité, grâce, notamment, à un tissu de chercheurs académiques hors pair" constatent les auteurs du rapport. Mais cela ne suffit pas : "elle ne peut se passer d’industriels réalisant des investissements importants et testant ces nouvelles innovations". Ce rapprochement entre chercheurs et entreprises est la condition sine qua non du succès du destin quantique de la France estime Paula Forteza : "seuls les pays qui auront osé prendre des risques trouveront une place dans ce nouveau tournant technologique et pourront donc garantir leur souveraineté".
Trois "hubs quantiques" sur le territoire français
Le rapport présenté par Paula Forteza avance pas moins de cinquante propositions pour faire de la France l'un des leaders européens et mondiaux de l'informatique quantique. Un objectif ambitieux et réalisable. Cela doit cependant passer par la mise en place une infrastructure de rang mondial dédiée à la recherche et à l'industrie. Concrètement, trois "hubs quantiques" pourraient être créés à Paris, à Saclay et à Grenoble.
Ces trois foyers auraient pour mission de faire travailler ensemble des chercheurs de différentes disciplines (physique quantique, informatique théorique et appliquée...), des ingénieurs, des industriels et des utilisateurs finaux. Mais pour travailler il faut des gens formés. Le volet formation n'a pas été oublié avec la création d'une spécialisation en ingénierie quantique pour répondre aux besoins des filières industrielles. "Il faut acculturer au maximum les ingénieurs informatiques au quantique, une formation en algorithmie quantique dans les principaux cycles d’ingénieurs en informatique mais aussi un module pour les masters en cryptographie nous paraît nécessaire".
Protéger le patrimoine scientifique
Les auteurs du rapport préconisent également un volet inspiré de l'intelligence économique : "la position de la France en matière de technologies quantiques encourage certains organismes ou États à s’intéresser à l’écosystème français et à cibler les acteurs les plus vulnérables, en pointe au niveau mondial. La protection du patrimoine scientifique et technologique et la diplomatie économique seront les piliers d’une stratégie d’intelligence économique efficace".
Tout cela a un coût : deux milliards sur cinq ans qui pourraient être réunis via un investissement public-privé. Le prix à payer pour "faire de la France un acteur incontournable des technologies quantiques sur la scène internationale".