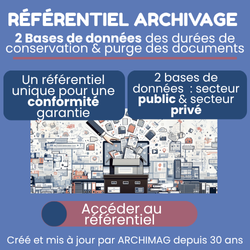RETROUVEZ CET ARTICLE ET PLUS ENCORE DANS NOTRE MAGAZINE : CONSTRUIRE ET ENTRETENIR SON STORYTELLING AVEC LES ARCHIVES
RETROUVEZ CET ARTICLE ET PLUS ENCORE DANS NOTRE MAGAZINE : CONSTRUIRE ET ENTRETENIR SON STORYTELLING AVEC LES ARCHIVES
 Découvrez Le Brief de l'IT, la newsletter thématique gratuite d'Archimag dédiée aux professionnels des data, de l'IT, de la digitalisation et de la transformation numérique !
Découvrez Le Brief de l'IT, la newsletter thématique gratuite d'Archimag dédiée aux professionnels des data, de l'IT, de la digitalisation et de la transformation numérique !
Avec son logo bleu qui s’imprime au bas de nombreuses images, l’Institut national de l’audiovisuel (Ina) est aujourd’hui considéré comme un média à part entière. Les comptes Instagram, TikTok et les chaînes YouTube de l’institution témoignent de l’engouement actuel pour les archives audiovisuelles, dont la tonalité, souvent teintée de nostalgie ou d’humour, semble fonctionner auprès des publics de tous âges.
La seconde vie des archives
Pour comprendre comment l’Institut s’est fait une place dans l’univers audiovisuel actuel, il faut remonter aux premières insertions d’archives dans les émissions d’actualités de la Radiodiffusion-télévision française (RTF). Dès 1952, une monteuse, Violette Franck, aurait ainsi pris l’initiative de découper, à même les pellicules, des bouts des premiers programmes télévisés pour illustrer ensuite de nouveaux formats d’actualités. Cette pratique s’est rapidement répandue à la télévision française.
Les créateurs considéraient en effet que les archives constituaient des illustrations beaucoup moins onéreuses que la réalisation de tournages supplémentaires. Face à ces besoins, et pour sauver les archives, les documentalistes ont pris en charge des tâches aussi variées que l’indexation des programmes télévisuels, leur classement, puis, au sein de ce fonds de plus en plus structuré, la sélection d’extraits ensuite insérés dans de nouveaux formats.
Lire aussi : Métiers de la veille et de la documentation : formation et compétences, la grande enquête 2025
Les documentalistes ont été à l’initiative d’outils inédits en Europe, qui ont permis un accès facilité aux archives pour les professionnels et professionnelles de l’audiovisuel, mais aussi pour la recherche.
En mettant en œuvre un système de documentation et de classement des archives de plus en plus structuré, en corpus ou mots-clefs, elles ont facilité le réusage d’archives audiovisuelles.
Elles ont aussi offert une visibilité croissante à ce patrimoine audiovisuel auprès du grand public, facilité par la numérisation des fonds de l’Ina à partir de 1999 (le Plan de sauvegarde et de numérisation (PSN), mené par l’Ina à partir de 1999, correspond au transfert des archives audiovisuelles de l’institut sur les supports numériques, ainsi qu’à l’achèvement d’une documentation audiovisuelle informatisée. Cela permit, entre autres, la mise en œuvre du site Ina.fr, qui a ouvert les archives de l’institution au grand public en ligne en 2006) : les archives illustrent aujourd’hui des programmes aussi variés que les actualités, les documentaires, les fictions, les bêtisiers, les talk-shows, et, aujourd’hui, divers montages proposés par les chaînes thématiques de l’Ina sur YouTube.
Les "petites mains" invisibles
L’histoire de la profession de documentaliste audiovisuel, de 1952 à nos jours, qui est l’objet de ma thèse, s’inscrit donc au cœur d’enjeux techniques et mémoriaux, de l’analogique au numérique, du réusage d’archives télévisuelles à la constitution d’un patrimoine audiovisuel collectif, organisé et valorisé auprès de publics variés.
Lire aussi : Comment nourrir l’IA avec de bonnes data ?
Ma thèse questionne aussi les interactions entre les documentalistes et les principaux secteurs clients des archives (réalisation, production, journalisme). En effet, leur activité a été créée par des femmes et est encore majoritairement occupée par celles-ci. Malgré leur rôle indéniable dans la valorisation des collections de l’Ina, les tâches des documentalistes sont encore aujourd’hui méconnues et leurs compétences invisibilisées.
Construite, vécue et perçue à travers une identité de genre très marquée, la profession n’a cessé de s’adapter au rythme et aux besoins des créateurs et créatrices de formats audiovisuels, souvent des hommes, dans des conditions matérielles de travail difficiles. "Petites mains" invisibles au générique, leur marge d’initiative apparaît toutefois importante dans les créations.
Après avoir retracé l’histoire de ces actrices cachées de la création audiovisuelle à base d’archives, je poursuis mon travail sur les professions de l’ombre, comme les monteurs et monteuses ou les scriptes.
Anna Tible