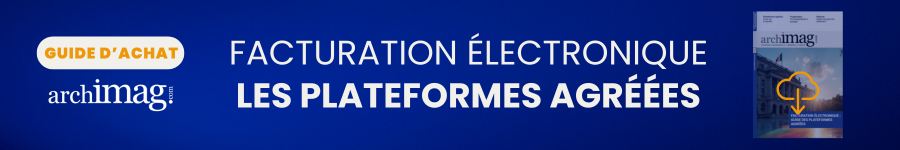Le volume d’informations disponibles ne cesse d’augmenter chaque année. Les points d'accès se sont multipliés entre la télévision, la radio, la presse écrite et web, les podcast ou encore, les réseaux sociaux. Et avec, les notions d’infobésité, de désinformation et de fatigue informationnelle ont pris place dans les discussions.
Selon l'étude "Les Français et la fatigue informationnelle. Mutations et tensions dans notre rapport à l’information", menée par l’Observatoire Société et Consommation (Obsoco), la Fondation Jean-Jaurès et Arte, la tendance est bien installée, puisque près de 77 % des Français se limitent ou cessent de consulter les informations.
En cause ? Une surenchère de débats polémiques (34 %), un manque de fiabilité de l’information (32 %), mais aussi un impact négatif sur le moral (31 %) et un manque d’intérêt (25 %). Ainsi, les Français ont adopté des stratégies de régulation. Ils sont 53 % à désactiver les notifications de leur téléphone et 30 % se forcent à ne pas allumer la télévision.
5 profils face à l'information
L’étude met en exergue cinq profils différents. Les "hyper informés en contrôle” représentent 11 % et se composent principalement d’hommes plus âgés (personnes retraitées et aisées) qui s’informent de manière intense, surtout via les médias traditionnels. De leur côté, les “hyperconnectés épuisés” (17 %), sont des jeunes urbains diplômés, pouvant consommer compulsivement de l'information. Surtout sur Internet et les réseaux sociaux.
Issus des milieux modestes, les “défiants distants” (18 %) expriment une forte réserve vis-à-vis des médias et des politiques. Tandis que les “défiants oppressés” (35 %), en majorité des femmes, sont dans un état de “fatigue informationnelle intense”. Ce groupe se sent souvent dépassé par l'information.
Lire aussi : La presse se lit désormais presque autant au format numérique que sur papier
Enfin, les 20 % restants ("ne sait pas - non-concernés") viennent davantage des zones périurbaines ou rurales. Ils ne sont pas dans une démarche de recherche d'information, sans pour autant être dans la défiance.
Vers plus de sobriété informationnelle ?
En termes de ressenti, 50 % des interrogés éprouvent “régulièrement” ou de “temps en temps” du stress ou de l’épuisement face au trop-plein d’informations.
Ils ont “l’impression de voir tout le temps les mêmes informations dans une journée” (85 %). Que cette massification les empêche de prendre du recul (59 %), de distinguer “ce qui est vraiment important” (51 %), “utile” (53 %) ou qui “permet de se faire une opinion” (49 %).
Comment renouer la confiance entre les émetteurs et les récepteurs d’informations ? Allons-nous basculer vers plus de sobriété informationnelle ? Pour les professionnels du secteur, cette baisse d’intérêt, de défiance et de fatigue informationnelle est sans aucun doute, l’un des enjeux majeurs de ces prochaines années. Car malgré tout, "pour une majorité de Français, il est important de s’informer régulièrement dans les médias (59 %). Pour un Français sur cinq, c’est même "très" important (20 %)", rappelle l'étude.