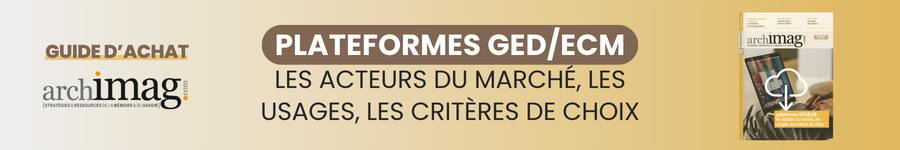No code : définition, actualité et enjeux
Qu'est-ce que le no-code / low-code ?
Définition - Le no-code est une approche du développement logiciel qui permet aux utilisateurs de créer des applications et d'automatiser des processus métier sans écrire une seule ligne de code. Grâce à des interfaces visuelles intuitives et des outils de type "glisser-déposer", même les personnes sans compétences techniques peuvent concevoir des solutions logicielles adaptées à leurs besoins spécifiques.
> Faites défiler la page pour découvrir tous les articles d'Archimag sur le no-code / low-code
Utilité du no-code
Le no-code démocratise la création de logiciels en rendant le développement accessible à un public plus large. Par exemple, une équipe marketing souhaitant créer une application de sondage client peut, grâce à une plateforme no-code, assembler l'application en quelques heures en glissant et déposant des modules tels que des champs de questions, des boutons et des outils de collecte de données sur un canevas visuel.
Selon Gartner, en 2025, 70 % des nouvelles applications seront développées avec des technologies low-code/no-code, contre moins de 25 % en 2020.
Lire aussi : Créer une base de gestion documentaire avec ChatGPT et des outils no-code
Avantages du no-code / low-code ?
Le no-code offre plusieurs avantages significatifs :
- Gain de temps : le développement est accéléré, permettant de créer des applications en quelques heures ou jours, contre plusieurs semaines ou mois avec les méthodes traditionnelles
- Réduction des coûts : les coûts associés au développement sont réduits, éliminant la nécessité de faire appel à une équipe de développeurs pour chaque projet
- Accessibilité : les plateformes no-code sont conçues pour être intuitives, permettant à des profils non techniques de créer et gérer des applications ou sites web
- Flexibilité et évolutivité : les projets peuvent évoluer rapidement, avec la possibilité d'ajouter des fonctionnalités ou d'intégrer de nouveaux outils sans contraintes de codage