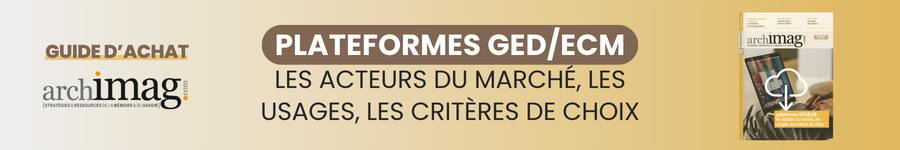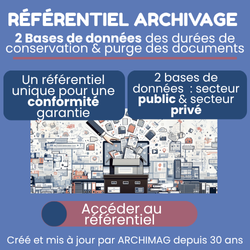Le patrimoine numérique grandit. On encourage la numérisation. Ainsi la valorisation numérique se déverse à son tour dans l’océan de données massives (big data), comme elle participe aussi à l’accélération de la circulation de l’information, constatée dès le milieu des années 2000.
Se pose alors la question de la conservation, avec pour corollaire celle de l’obsolescence des matériels et des logiciels. Pour leur part, les professionnels du patrimoine, archivistes en tête, connaissent les règles et les technologies d’un archivage électronique digne de ce nom.
L’archivage du web, lui, se trouve notamment entre les mains d’une société privée, Internet Archive, et en France des services de dépôt légal de la BNF et de l’Ina. Il s’effectue via une collecte à partir d’échantillons et via une collecte ciblée. L’exhaustivité ne peut être atteinte. Des morceaux de patrimoine échapperont fatalement à la connaissance des générations futures.
Une fréquentation en hausse : opportunités et limites de la médiation numérique
Voir une œuvre sans aller au musée, explorer un site en restant chez soi : grâce au numérique, la valorisation patrimoniale permet cela, en soignant au mieux l’expérience utilisateur. Mais l’écran ou le casque de réalité virtuelle apportent-ils toute la satisfaction voulue ? L’utilisateur est-il assez discipliné, éduqué (fracture numérique) pour en profiter complètement ? Une alerte, un pop-up ne risquent-ils pas de le détourner ? L’on dénonce de plus en plus les dangers de la surconsommation d’écran, pas seulement chez les plus jeunes. Surtout, le ressenti, l’émotion, la connaissance pleine du patrimoine peuvent-ils se passer d’une confrontation avec le réel ? Qui plus est lorsque cet instant est partagé avec d’autres. Pour certains, dématérialisation rime avec désincarnation, déshumanisation.
Déjà nombre d’institutions s’interrogent sur l’équilibre entre leurs offres physiques et virtuelles. Des recherches sont menées pour savoir ce que les visiteurs souhaitent afin de créer des expériences plus stimulantes. Notamment à cause de l’appétence nouvelle apparue après la pandémie de Covid-19, l’afflux excessif de touristes et de visiteurs devient parfois problématique. Des sites en souffrent, comme par exemple l’Île de Bréhat (Côtes-d’Armor) ou les Calanques de Marseille.
Les solutions préconisées sont de limiter la fréquentation, de mettre en place un accès payant, une réservation de créneau horaire - ce que nombre de sites historiques ou de musées pratiquent depuis longtemps. Ainsi, l’accès à la Calanque de Sugiton se fait sur réservation gratuite pendant la période estivale. Il ne s’agit pas de brimer les visiteurs, mais de leur faire prendre conscience des problèmes de la surfréquentation, de les inviter à mieux « consommer » le patrimoine dans une approche plus qualitative. Visiter moins, mais mieux est une voix vers un tourisme responsable et durable.
Le patrimoine face à l’urgence écologique : vers une gestion responsable et durable
Le dérèglement climatique pose un défi au patrimoine, qu’il soit matériel ou immatériel, naturel ou numérique. Les sautes d’humeur de la météo sont de plus en plus dévastatrices, accroissant les risques de dégradation et d’endommagement. Dans les institutions patrimoniales, plus que jamais sont contrôlées la température, l’humidité et la qualité de l’air - ceci en recourant de plus en plus à des capteurs connectés. Les acteurs publics comme privés s’impliquent dans des démarches écoresponsables, visent la sobriété énergétique, gardent un oeil sur leur bilan carbone. Ces préoccupations sont présentes de la conservation à la valorisation. Pour la restauration de Notre-Dame de Paris, on utilise pour les charpentes un bois issu de forêts bénéficiant d’une gestion durable. La région normande propose un « tarif bas carbone Normandie » pour l’accès à certains sites culturels et touristiques aux visiteurs venus en train, car ou vélo. Les idées ne demandent qu’à fleurir.
Vous souhaitez en savoir plus ? Téléchargez gratuitement le Supplément d'Archimag "Valorisez votre patrimoine : il y a urgence" en cliquant ici !