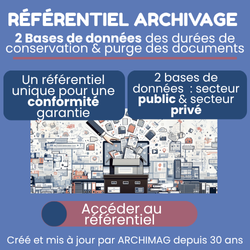CET ARTICLE A INITIALEMENT ÉTÉ PUBLIÉ DANS ARCHIMAG N°384 : Secteur public : comment l’administration pilote sa digitalisation
CET ARTICLE A INITIALEMENT ÉTÉ PUBLIÉ DANS ARCHIMAG N°384 : Secteur public : comment l’administration pilote sa digitalisation
 Découvrez Le Brief de l'IT, la newsletter thématique gratuite d'Archimag dédiée aux professionnels des data, de l'IT, de la digitalisation et de la transformation numérique !
Découvrez Le Brief de l'IT, la newsletter thématique gratuite d'Archimag dédiée aux professionnels des data, de l'IT, de la digitalisation et de la transformation numérique !
Pourquoi avez-vous choisi l’expression "Généalogie 4.0" pour évoquer l’évolution de la généalogie ?
 La généalogie 4.0 désigne la quatrième révolution technologique de la généalogie. La première grande révolution correspond à l’utilisation des microfiches et des microfilms dans les années 1980. Les campagnes de microfilmage de l’état civil français, réalisées par la société généalogique de l’Utah et par les services d’archives départementales, ont changé le rapport aux archives. Les bobines permettaient un usage massif alors que les dépôts d’archives restreignaient le nombre de documents originaux consultables.
La généalogie 4.0 désigne la quatrième révolution technologique de la généalogie. La première grande révolution correspond à l’utilisation des microfiches et des microfilms dans les années 1980. Les campagnes de microfilmage de l’état civil français, réalisées par la société généalogique de l’Utah et par les services d’archives départementales, ont changé le rapport aux archives. Les bobines permettaient un usage massif alors que les dépôts d’archives restreignaient le nombre de documents originaux consultables.
La deuxième révolution est celle de l’informatique, avec l’arrivée des premières bases de données généalogiques. De nouveaux instruments de recherche informatisés ont également été créés au sein des services d’archives. Les généalogistes se sont aussi emparés du Minitel, avec des services dédiés à leur activité. Dans le même temps, des logiciels spécifiques ont vu le jour à partir de 1987.
La troisième révolution est celle d’internet, qui a véritablement changé la façon de pratiquer la généalogie. La première plateforme collaborative, Geneanet, a vu le jour en décembre 1996. Les bases de données, jusqu’ici installées sur des ordinateurs, ont été mises en ligne, devenant accessibles à distance. Et surtout, depuis les années 2010, la numérisation des sources elles-mêmes et leur mise en ligne ont été un grand bouleversement.
La généalogie est entrée dans l’ère 4.0 grâce aux nouvelles technologies, telles que l’intelligence artificielle (IA).
Lire aussi : Dossier - IA et patrimoine : les professionnels témoignent
Quels sont les apports concrets de l’IA dans l’activité des généalogistes ?
Parmi les projets innovants aux retombées bénéfiques pour les généalogistes, je citerais en premier lieu les initiatives menées par les services d’archives, que celles-ci soient nationales, départementales ou spécialisées. Grâce à l’IA, ces projets permettent de réaliser de l’indexation automatique, de créer de nouveaux instruments de recherche, de transcrire des textes imprimés, mais aussi de transcrire automatiquement des textes manuscrits. Ils permettent aux généalogistes de faire de la recherche plein texte dans la presse ancienne, dans les répertoires de notaires ou encore dans les registres matricules militaires…
Par ailleurs, les plateformes de généalogie et les éditeurs utilisent également l’IA pour fournir des outils innovants aux généalogistes.
Enfin, l’intelligence artificielle générative peut aussi aider les généalogistes à raconter des histoires de famille en transcrivant des récits enregistrés, en transformant des détails bruts en récit ou en chronologie. Mais l’essentiel n’est pas là, car l’IA générative offre surtout de nombreux avantages lorsqu’elle est exploitée sur des données fiables : les Archives nationales d’outre-mer s’apprêtent à lancer un projet basé sur l’exploitation de ses propres fonds. L’IA devient alors extrêmement performante pour creuser dans les différents inventaires et répertoires.
Que peut apporter la technologie HTR (reconnaissance d’écritures manuscrites) dans la pratique des généalogistes ?
La vision par ordinateur (computer vision) - lorsqu’un algorithme est par exemple en mesure de distinguer un chien d’un chat - et la reconnaissance optique de caractères d’imprimerie (OCR) - qui permet la recherche plein texte sur Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF - sont très utiles pour les généalogistes. L’HTR, qui permet de transcrire et d’indexer plus rapidement des fonds d’archives, les rendant accessibles en ligne aux généalogistes, est très prometteuse.
Le projet Lectaurep des Archives nationales, dont l’objectif est d’indexer automatiquement les répertoires des notaires parisiens, est une bonne illustration de l’apport de l’IA : il suffit d’entrer le nom d’une personne dans un moteur de recherche pour accéder à l’image du répertoire qui cite cette personne, mais aussi à sa transcription et à la côte pour consulter les minutes aux Archives nationales.
Le projet Simara, quant à lui, permet de valoriser près de 800 000 fiches et 100 000 pages d’inventaires manuscrits. Là aussi, il suffit désormais d’utiliser un moteur de recherche pour trouver des pépites. C’est d’autant plus remarquable que personne ne va fouiller à la main 800 000 fiches pour trouver un nom.
Lire aussi : Lectaurep : l’IA appliquée aux archives notariales
D’autres projets innovants en matière archivistique ont-ils des retombées bénéfiques pour les généalogistes ?
Outre Lectaurep et Simara, il faut citer le travail réalisé par le Service historique de la Défense (SHD) sur les registres matricules des militaires des anciennes colonies françaises. Ces registres matricules ont été indexés à une vitesse vertigineuse par l’IA. Autre réalisation, le projet MaritimIA, qui porte sur des archives relatives à 120 000 marins : ces images ont pu être indexées et sont accessibles en ligne, sans avoir à se déplacer dans des dépôts d’archives dispersés sur le territoire national.
A contrario, l’IA a-t-elle des effets nocifs pour les généalogistes ?
Je parlerais plutôt d’aspect négatif, car tout dépend de la qualité de l’instruction donnée à l’IA. Si l’instruction est mauvaise, la réponse pourra être erronée. Un généalogiste qui se respecte doit vérifier ses sources et consulter les documents d’archives. Il ne doit pas se contenter de ce qu’il trouve sur internet. L’IA permet, certes, d’accéder plus rapidement à l’information, mais elle ne remplace pas les compétences des généalogistes : savoir lire un texte, comprendre les types d’archives, connaître le vocabulaire d’une matrice cadastrale, par exemple…
La France est-elle un pays précurseur en matière d’IA appliquée aux archives ?
Ce qui est certain, c’est que la France n’est pas en retard. D’une façon générale, notre pays n’a pas à rougir sur l’accès aux archives. En tant que généalogiste, je peux en témoigner : la France est un pays où il fait bon chercher ! Voyez en Italie, en Allemagne ou en Angleterre, les choses ne sont pas aussi cadrées qu’en France. J’ajoute que l’accès aux documents est gratuit, ce qui n’est pas le cas de certains pays.
Combien de personnes ont-elles une activité de généalogie en France ?
Il faut distinguer les généalogistes successoraux et les généalogistes familiaux qui n’exercent pas le même métier. L’Union professionnelle des généalogistes familiaux regroupe 76 professionnels. L’adhésion à UPRO-G est un gage de professionnalisme.
Quant aux généalogistes amateurs, ils étaient estimés à environ 10 millions en 2011 par la Fédération française de généalogie. En réalité, il n’existe pas d’étude rigoureuse sur le sujet. En me basant sur le nombre d’utilisateurs déclarant avoir une activité généalogique sur des sites des services d’archives, je suis parvenue à un chiffre d’environ 18 millions.
Ce chiffre est très impressionnant. Le goût pour la généalogie est-il une spécificité française ?
Le goût pour la généalogie est bien ancré en France quand on le compare avec d’autres pays européens. Le monde anglo-saxon est également assez friand de la discipline, mais avec une pratique qui privilégie la famille proche (parents, grands-parents…) et l’ADN, ce qui n’est pas autorisé ici. En France, les généalogistes s’intéressent volontiers à une histoire plus large. Cela s’explique probablement par la Révolution industrielle, qui a entraîné une désertification des campagnes. Les générations déracinées ont souhaité renouer avec leur histoire à partir des années 1980.
Les services d’archives publics sont-ils toujours des lieux incontournables pour les généalogistes ?
Assurément pour les généalogistes professionnels. Si les amateurs consultent avant tout les archives mises en ligne, un certain nombre apprécie de fréquenter les dépôts d’archives.