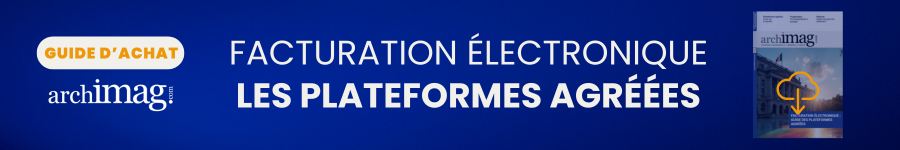D’après le rapport annuel de l’Observatoire de l’égalité entre femmes et hommes dans la culture et la communication, la parité progresse encore trop peu dans le monde du livre, de l’édition et du patrimoine.
Que ce soit en termes de rémunération ou d’accès aux postes à haute responsabilité, les femmes sont toujours loin derrières.
Les écarts de salaires entre hommes et femmes stagnent autour de 20%. Parmi les 10% de salariés les moins bien rémunérés dans les entreprises culturelles, 59% sont des femmes. Et plus on monte dans la hiérarchie salariale, moins on voit de femmes.
La part des femmes à la direction des 100 plus grosses entreprises culturelles n’a pas non plus changé depuis l’année dernière. Seulement 9% de femmes sont à la tête d’entreprises du monde du livre, de la presse et de l’édition. Côté patrimoine, les directrices de musées sont deux fois moins nombreuses que les directeurs.
Le centre national du livre : des efforts mais peut mieux faire
Il faut tout de même noter les efforts du CNL pour respecter la parité. En 2013, la part des femmes était de 42% pour 50% aujourd’hui. Mais la parité reste déséquilibrée au sein des différentes commissions. La commission de la diffusion en bibliothèques semble exclusivement réservée aux femmes (11 femmes pour 1 homme) et inversement, celle des librairies francophones à l’étranger est plutôt masculine (10 hommes pour 3 femmes).
Quant aux subventions accordées, le centre national du livre privilégie les hommes à 62% mais les écarts dans le montant des aides se réduit. En moyenne, 5251 euros sont alloués aux femmes contre 6462 euros pour les hommes.
Pour la ministre de la Culture Fleur Pellerin, "il reste encore beaucoup à faire pour promouvoir l’égalité dans l’exercice dans l'exercice des responsabilités de direction dans l'administration de la culture et de la communication, comme dans les institutions culturelles".