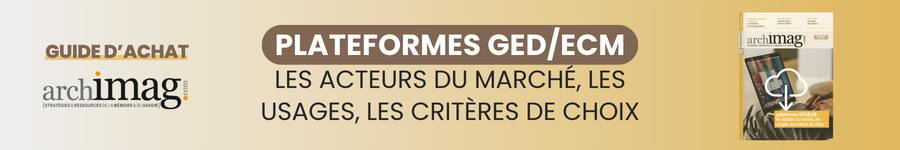Le modèle actuel d'édition scientifique dans les revues académiques ne satisfait pas les chercheurs. C'est ce que révèle l'enquête Couperin 2019 publiée ce mois-ci sur les Pratiques de publications et d'accès ouvert des chercheurs français en 2019, dans laquelle les coûts accessifs, la cession exclusive des droits d'auteur ainsi que la barrière de lecture induite par les abonnements sont massivement dénoncés par les répondants, qui prônent massivement un accès ouvert (open access) sans contrainte. Ce rapport révèle également que 60 % des chercheurs de moins de 35 ans déclarent utiliser des sites illégaux pour se documenter alors que moins d'un sur trois choisit sa bibliothèque universitaire.
Les résultats de l'enquête publiée par le consortium Couperin ne sont pas aussi radicaux qu'ils en ont l'air. Certes, les chercheurs adhèrent à l'enjeu de l'open access et se montrent favorables à la diffusion des résultats de la science de façon libre et gratuite. Mais "cette objectif doit pour eux être réalisé sans effort, de manière simple, lisible et sans financement direct des laboratoires", précise l'enquête. Par ailleurs, les chercheurs ne souhaitent pas que l'open access bouscule le paysage des revues traditionnelles de leur discipline, auxquelles ils demeurent attachés.
Les éditeurs scientifiques jugés trop chers
Néanmoins, il est à noter que l'apport des éditeurs scientifiques est massivement pointé du doigt par les répondants de l'enquête, qui dénoncent à 85 % leur rapport qualité/prix et à 65 % la valeur ajoutée des maisons d'édition. 80 % des chercheurs ayant répondu à l'enquête estiment également que les coûts excessifs, la cession exclusive des droits d'auteur, ainsi que la barrière de lecture induite par les abonnements sont des limites majeures du système actuel. Seule la qualité des plateformes semble faire l'unanimité dans les communautés scientifiques, à près de 80 %.
"Tous les moyens sont bons pour accéder au texte intégral"
La barrière de l'abonnement, qui limite l'accès à l'information - pourtant très importante dans le processus de recherche - des chercheurs, les amène a trouver des solutions pour accéder à l'article voulu. "Tous les moyens sont bons pour accéder au texte intégral", précise le consortium Couperin dans la synthèse de son enquête. Et si 90 % des répondants n'abandonnent pas leur recherche quand l'accès n'est pas disponible, moins de 5 % choisissent la solution payante proposée par l'éditeur.
Des pratiques différentes selon l'âge des chercheurs
Mais alors comment font-ils pour se documenter quand l'accès au texte intégral leur est fermé ? La moitié des répondants (avec une plus grande proportion pour les plus âgés) font appel au réseau scientifique (demande auprès des auteurs ou demande de copie auprès de collègues abonnés ou de bibliothèques). "Cette pratique est complétée par une recherche sur les plateformes légales (archives ouvertes ou réseaux sociaux), explique le consortium Couperin ; "ainsi que sur les plateformes illégales".

Sci-hub plutôt que la bibliothèque
Car les jeunes chercheurs l'ont reconnu : 60 % des moins de 35 ans avouent utiliser les sites illégaux comme sci-hub pour consulter un document dont l'accès leur est fermé. Une pratique qui concerne surtout les plus jeunes (les 55 ans et plus ne sont que 22 % à se rendre sur de tels sites). Les plus jeunes sont également les moins enclins à se tourner alors vers leur bibliothèque, contrairement aux chercheurs plus âgés. 28 % seulement des chercheurs de moins de 35 ans se tournent vers la bibliothèque de l'établissement pour se documenter. Que faut-il en déduire : les jeunes chercheurs sont-ils au courant de toutes les ressources que proposent leur bibliothèque universitaire ? Cette documentation est-elle suffisamment mise en valeur ? Leurs outils sont-il assez connus ? N'hésitez pas à donner votre avis !