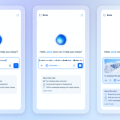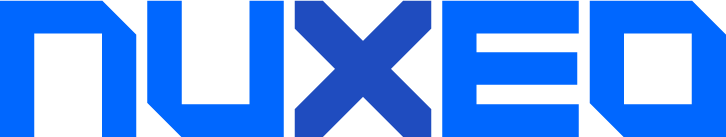Soumis à la pression de trouver de nouveaux sujets et de développer la notoriété de ses articles, le journaliste 2.0 a mis les nouvelles technologies au service de son métier. Une étude anglaise s’est intéressée à la place des réseaux sociaux dans les pratiques journalistiques à l’ère du numérique.
Le web 2.0 et la globalisation des médias ont transformé le métier du journaliste : celui-ci est devenu polyvalent, une sorte d'"homme orchestre" jonglant entre les différentes plateformes et supports, s’enrichissant d’un nouvel éventail de sources (cf : Interview de Rémi Le Champion dans Archimag de février 2013). Parmi elles, les réseaux sociaux, véritables acteurs de la démocratisation de l’information. L’agence de relations publiques anglaise 10 Yetis s’est intéressée à la place que ces plateformes émergentes occupent dans les pratiques journalistiques européennes et américaines (1) : réalisée entre janvier et février 2013, l’étude confirme l’influence progressive de Twitter et Wikipedia, en tête des sources de recherche et des outils de partage d’informations.
En effet, 75 % des journalistes britanniques déclarent utiliser Twitter comme source de sujets d’article. 15 % des journalistes français et anglais vont même jusqu’à utiliser les réseaux sociaux pour sourcer leurs informations (contrairement à l’Allemagne et aux Etats-Unis, qui n’en font pas mention). Seuls les journalistes allemands restent frileux à utiliser Twitter (17 %) préférant surfer sur Wikipédia pour leurs recherches (84 %). L'encyclopédie libre sur Internet attire presqu'autant les journalistes brittaniques (76 %) et français (73 %).
Les journalistes interrogés justifient massivement cette utilisation des réseaux sociaux par la double pression qu’ils subissent : trouver sans cesse de nouveaux sujets d’articles ainsi que promouvoir leurs articles auprès des internautes. Twitter n’a-t-il d’ailleurs pas été le premier média à annoncer la mort de Steve Jobs ou le raid contre Ben Laden ?
(1) Les conditions de l’étude : panel constitué de 2605 journalistes américains (823) et européens (612 Français, 648 Britanniques, 522 Allemands), issus de divers secteurs (actualité, mode, informatique, etc). En France, seuls des journalistes du Figaro, des Echos, de 20 Minutes ou encore du Parisien ont été sollicités pour l’enquête. A noter cependant : aucun média du web (tel Slate, Mediapart ou encore Atlantico) n’y a participé.
Les résultats complets de l’étude peuvent être téléchargés ici.