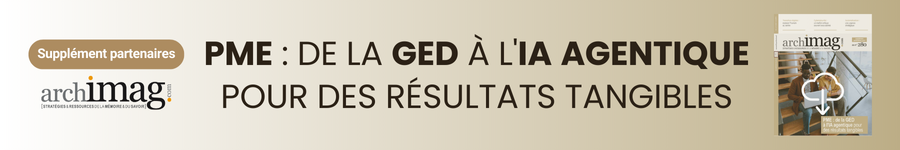Le 26 février 2025, un jalon important a été posé dans le paysage de la recherche et de la documentation en France. La Bibliothèque nationale de France (BnF), l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) et l’École nationale des chartes-PSL (ENC) ont signé leur première convention tripartite, officialisant un cadre de coopération scientifique et pédagogique pour les cinq prochaines années afin de développer des activités de formation et de recherche communes ou complémentaires et de favoriser la diffusion et le partage des connaissances produites.
Cette alliance s’appuie sur des collaborations bilatérales déjà existantes et vise à intensifier les synergies entre ces trois institutions phares du quartier parisien Richelieu, pôle majeur du savoir et du patrimoine documentaire en France.
Lire aussi : Snoop, le moteur de recherche Ina-BnF-Inria dopé à l'IA
Formation et recherche
Cette convention prévoit l’accueil des élèves archivistes paléographes et des étudiants de l’ENC au sein de la BnF et de l’INHA, sous forme de stages et de visites. Dans la continuité des collaborations précédentes, des programmes communs de recherche seront développés, à l’image du projet « Richelieu : histoire du quartier », une étude de ses dynamiques architecturales, humaines et économiques en croisant des sources iconographiques et cartographiques, ainsi que des séminaires et des rencontres tels que les « Ateliers du Campus Richelieu ».
Lire aussi : L'Ecole nationale des chartes lance sa fondation destinée à lever des fonds
Partage et coopération autour de la connaissance
Par ailleurs, les trois institutions s’engagent à intensifier la diffusion des connaissances par la valorisation des activités scientifiques à travers : des publications académiques, l’organisation d’expositions et d’actions de médiation numérique et le développement de bases de données partagées, comme il a pu être fait précédemment avec AGORHA, Gallica Images et Datacatalogue.
Elles enrichiront également leurs collections documentaires en intégrant de nouvelles acquisitions (numériques et patrimoniales). En parallèle, elles engageront des actions communes en matière de conservation et de numérisation, afin d’améliorer l’interopérabilité de leurs bases de données.