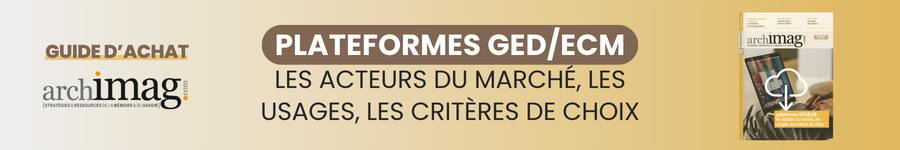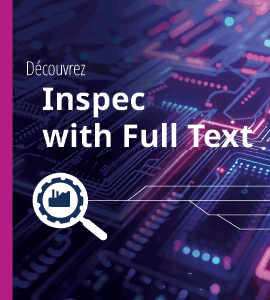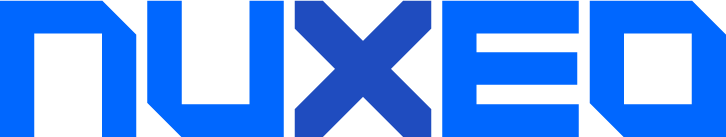Selon le Baromètre français de la science ouverte (BSO) plus de la moitié des publications scientifiques françaises sont désormais en accès ouvert : 56 % de la production de 2019 (mesurée en 2020) soit l'équivalent de 87 000 publications. Ce taux confirme une tendance observée depuis plusieurs années avec la politique nationale de science ouverte.
"Pour la première fois, le taux d’ouverture des publications de la dernière année dépasse celui des autres, ce qui témoigne de délais plus courts dans la mise à disposition en accès ouvert, quelle que soit la modalité d’ouverture" se réjouit le comité Ouvrir la science. En 2018, le nombre de publications scientifiques françaises en accès ouvert s'élevait à 74 996 soit 49 % des 155 000 publications recensées.
Près de trois-quarts des publications de mathématiques
Mais toutes les disciplines ne sont pas logées à la même enseigne. Avec un taux de 74,9 %, les mathématiques sont en tête de l'accès ouvert principalement en archives ouvertes, devant la biologie fondamentale (69 %). Avec 44,9 %, les sciences humaines ne bénéficient pas encore du même engouement pour l'accès ouvert. Pour le comité Ouvrir la science, "ces différences ne doivent pas occulter le fait que la hausse du taux d’ouverture est constatée dans toutes les disciplines, en dépit d’une disparité encore forte".