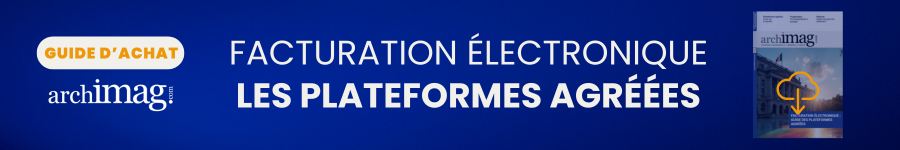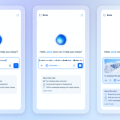Alors que le mouvement open science ne cesse de gagner du terrain, l'INHA annonce la publication de sa propre charte en faveur de la science ouverte. Ce document porte sur les publications scientifiques de l'INHA bien sûr mais aussi sur ses données et les codes sources des outils développés par l’Institut.
L'INHA parachève ainsi une stratégie engagée il y a plus de vingt ans avec la mise en place d'une Cellule d’ingénierie documentaire chargée de réfléchir à la gestion des données numériques de la recherche. Cette réflexion s'est traduite par la création de la plateforme des données de la recherche AGORHA qui, à ce jour, compte près de 250 000 notices documentaires publiées, dont environ 180 000 sont illustrées. Les métadonnées sont mises à disposition, depuis 2018, sous une licence ouverte Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
Une charte mise à jour périodiquement
"Cette charte, sera révisée et mise à jour périodiquement, en adéquation avec les transformations du monde numérique et les évolutions des plans nationaux et internationaux pour la science ouverte" explique l'INHA. Elle s'inscrit également dans le Plan national pour la science ouverte (PNSO) qui définit la science ouverte comme "la diffusion sans entrave des résultats, des méthodes et des produits de la recherche scientifique".
Selon le Baromètre de la Science Ouverte (BSO), 67 % des 160 000 publications scientifiques françaises publiées en 2021 étaient en accès ouvert en décembre 2022. En 2018, le nombre de publications scientifiques françaises en accès ouvert ne s’élevait qu'à 74 996 soit 49 % des 155 000 publications recensées.