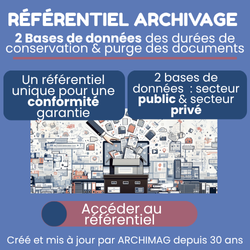CET ARTICLE A INITIALEMENT ÉTÉ PUBLIÉ DANS ARCHIMAG N°386
CET ARTICLE A INITIALEMENT ÉTÉ PUBLIÉ DANS ARCHIMAG N°386
 Découvrez Le Brief de l'IT, la newsletter thématique gratuite d'Archimag dédiée aux professionnels des data, de l'IT, de la digitalisation et de la transformation numérique !
Découvrez Le Brief de l'IT, la newsletter thématique gratuite d'Archimag dédiée aux professionnels des data, de l'IT, de la digitalisation et de la transformation numérique !
Avec la pandémie du Covid-19, le télétravail a été massivement expérimenté. Au point que le recours à cette modalité de travail est devenu significatif en France, faisant entrer les collaborateurs dans un environnement flexible où l’organisation et la restitution du travail se font ailleurs qu’au bureau et s’appuient sur les technologies numériques. Si de récentes statistiques indiquent que la proportion de la population active pratiquant le télétravail est en baisse, de nombreux métiers l’ont intégré dans leurs habitudes de façon plus ou moins stable.
Lire aussi : Dossier : Les (nouvelles) meilleures pratiques collaboratives
Des interrogations pour les services d’archives
Les métiers de l’information documentaire n’ont pas été épargnés par cette transformation. Les archivistes, en particulier, se sont trouvés face à un changement inattendu, mais les effets de cette forme d’organisation du travail sur la profession restent encore peu explorés. Cette révolution survenue dans le monde du travail engage une réflexion plus large sur l’identité professionnelle. Le télétravail permet ainsi d’interroger le rapport au métier auquel il s’assimile.
Nul doute qu’il "draine un nombre impressionnant d’enjeux qui touchent au travail et à l’organisation, dans leur raison d’être et d’exister" ("Le télétravail, un mode de vie", Laurent Taskin, Presses de Sciences Po, 2025). Au regard des services d’archives, il soulève des interrogations spécifiques : comment un métier historiquement fondé sur la manipulation des documents matériels et la présence physique dans les locaux s’accommode-t-il du travail à distance ? Quelles influences le télétravail a-t-il sur les pratiques archivistiques, sur l’organisation interne des services d’archives et sur les représentations professionnelles des archivistes ?
Ces questions ont motivé notre projet de mémoire, lequel prend appui sur une étude de terrain menée au sein du Département archives de Sciences Po, à Paris, et sur d’autres entretiens réalisés auprès d’archivistes en activité dans le Maine-et-Loire. Notre objectif : comprendre comment le télétravail se met en place dans les services d’archives en France et comment les archivistes le vivent, le perçoivent et se l’approprient dans leur quotidien professionnel.
Lire aussi : Sciences Po, 150 ans d'archives à explorer
Le télétravail en pratique
Les enquêtes confirment que la pratique du télétravail est accordée aux archivistes. Leur qualification et leurs compétences professionnelles correspondent à un poste de télétravailleur. Au total, sept archivistes nous ont partagé leur expérience du travail à distance. Progressivement, ils ont plongé dans les possibilités, les perspectives, et parfois les tensions, ouvertes par cette évolution récente. Ils reconnaissent surtout que le télétravail fait partie de la vague de transformations numériques qu’aucune filière ne saurait ignorer aujourd’hui. Pour eux, télétravailler revient à considérer les atouts numériques dans leur travail de gestion des ressources documentaires.
Le recours au télétravail est à la fois une introduction de technologies professionnelles et une "transformation de l’approche du travail et de l’organisation structurelle". On se trouve dans un environnement qui entend améliorer l’expérience du travail à travers les plateformes digitales utilisées au sein des services d’archives. Dans leur présentation du télétravail, les archivistes arrivent à distinguer essentiellement son opérationnalité et son cadre juridique.
La pratique du travail à distance mobilise tout un dispositif de technologies et de plateformes numériques capables d’élargir les limites du bureau physique et les services d’archives sont entrés dans ce vaste écosystème. Il s’agit généralement d’une "digital workplace" mise en place par l’employeur, un lieu de travail métamorphosé où l’archiviste exploite un ensemble de logiciels et d’outils (cloud, messagerie instantanée, visioconférence, etc.), avec une connexion internet lui permettant de remplir efficacement certaines de ses tâches. C’est une transformation qui apporte des opportunités exploitables, rendant possible le travail collaboratif à distance et bien plus encore.
Les tâches télétravaillables pour archivistes
Toutefois, la modernité instaurée dans l’organisation professionnelle mérite d’être continuellement accompagnée. Il faudra l’adapter convenablement pour répondre aux besoins spécifiques de chaque service. Dans le milieu des archivistes, la distinction est clairement établie entre les tâches télétravaillables et celles qui ne peuvent pas l’être. Les nouveaux outils numériques d’usage offrent un espace collaboratif en créant une source d’informations centralisée pour les activités quotidiennes.
Ils permettent notamment de rédiger soigneusement les inventaires ou instruments de recherche (IR), de restructurer ou retravailler des bases de données mises à la disposition des utilisateurs. Les services que nous avons interrogés ont à cœur d’enrichir la présentation de leurs IR avec un maximum de notices. Il s’agit de bien les rédiger dans le respect des normes du métier, de procéder à leur relecture, de corriger la description faite par le service producteur, souvent recouverte d’une écriture difficilement compréhensible.
Dans la mesure où ces tâches sont réalisées sur écran, depuis le logiciel commun de gestion d’archives et sur internet, et qu’elles demandent de rester concentrer plus longtemps, les archivistes préfèrent actuellement les exécuter en télétravail. Ils déclarent gagner en efficacité et en qualité lorsqu’ils ne sont pas dérangés par les sollicitations du bureau. Le travail est moins haché et on s’y consacre avec plus d’engouement, avec même la tentation de réaliser des heures supplémentaires. Un professionnel nous a d’ailleurs confié que le télétravail a même permis à sa hiérarchie de mesurer la masse de travail chronophage (sur la description et la construction d’IR) qui n’était, jusque-là, pas forcément perçue.
Il n’en demeure pas moins qu’à l’heure actuelle, les bénéfices du télétravail ne sont pas proportionnels à l’apport professionnel de l’activité de l’archiviste. Seule une petite partie de la chaîne archivistique est concernée.
D’un côté, le potentiel généré par la technologie pour alléger une partie du travail existe ; de l’autre, on recense des facteurs qui n’encouragent pas l’exécution en ligne de certaines missions ou encore la difficulté de transmettre à distance la culture du métier. La pratique du télétravail dans les archives continue à s’organiser. Elle nécessite, entre autres, que l’on détermine encore mieux les tâches assignées, les projets mis en œuvre, les délais équivalents au travail à effectuer en dehors du site ou précisément à domicile.
Lire aussi : Dossier - bibliothécaires, documentalistes et archivistes : où en est la convergence ?
Les archivistes satisfaits du télétravail
Concernant le cadre de mise en place du télétravail, celui-ci repose sur un principe de double volontariat de l’employeur et du collaborateur. Un accord commun fixe une modalité plutôt régulière autour d’un large consensus de travail hybride qui permet d’alterner les périodes de présentiel et de distanciel. Pour les archivistes, la périodicité de jours de travail à distance est assez modeste (20 % maximum) : un jour par semaine suffirait, selon les responsables de service. Certains agents, au contraire, expriment leur aspiration à une plus grande autonomie dans la gestion des tâches et accepteraient de passer à deux jours si le volume du travail réalisable à distance correspond.
Actuellement, plusieurs entreprises ou organisations reviennent sur les accords du télétravail conclus à partir de 2020 et les services d’archives pourraient, eux aussi, en redéfinir les règles réciproques. En posant notamment un cadre qui soit à la fois conforme aux objectifs fixés et vecteur d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. De leur côté, les archivistes semblent satisfaits de leur expérience actuelle du télétravail. L’évolution de la société les conduit à accepter cette nouvelle forme d’organisation en ajoutant à leur culture très présentielle l’aspect contemporain du travail à distance, avec les défis qui en découlent.
Si ce mémoire n’est pas une réflexion technique sur le télétravail, il entend saisir comment un secteur professionnel souvent considéré comme "traditionnel" participe lui aussi aux mutations du monde du travail. Car, si le télétravail ne change pas fondamentalement les missions d’un service d’archives, il entraîne des nouveautés dans les services, révèle une efficacité pour avancer plus vite sur certaines tâches et suscite parfois des tensions dans son organisation qui promet de se perfectionner. La gestion des archives est désormais révélatrice de bouleversements silencieux dus à une norme de travail mouvante ; il faudra du temps pour en mesurer toutes les conséquences.
L'auteur, Grâce Jasnel Manima, est étudiant du master d’Archives de l’Université d’Angers.