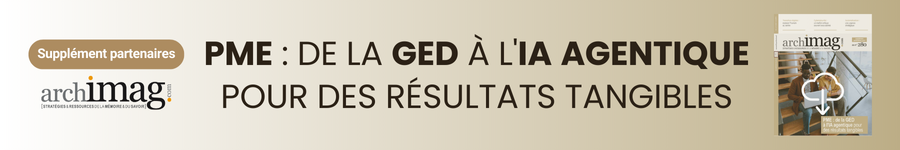Les plus importantes destructions de bibliothèques ont eu lieu pendant la seconde guerre mondiale.
Depuis l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie (48 avant J.-C.), de nombreux autres patrimoines documentaires ont été détruits au cours de l'histoire : parchemins de la Bibliothèque de Constantinople en 473, codex mayas en 1562, manuscrits de la bibliothèque nationale de Serbie en 1942, livres des bibliothèques polonaises et allemandes pendant la seconde guerre mondiale... Sans oublier les récents saccages des manuscrits de Tombouctou au Mali.
Il est aujourd'hui possible d'évaluer ces destructions en valeur numérique. Selon le journaliste Samuel Granados, auteur d'une infographie publiée dans le supplément littéraire du quotidien italien Corriere della sera, (traduite en français par Courrier international) cette évaluation s'appuie sur une estimation très précise : 1 gigaoctet (Go) représente 739 livres.
L'équivalent de 18 285 Go détruits dans les bibliothèques polonaises
A la lumière de ce calcul, ce sont les bibliothèques polonaises qui ont le plus souffert de destructions : entre 1939 et 1945, les bombardements auraient détruit l'équivalent de 18 285,7 gigaoctets. Viennent ensuite les bibliothèques allemandes, également pendant la seconde guerre mondiale, avec des pertes estimées à 12 084 gigaoctets.
L'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie représenterait un total de 571,4 Go (soit moins que la mémoire d'un ordinateur portable d'aujourd'hui). Les dernières exactions menées en 2013 contre contre les manuscrits de Tombouctou (Mali) n'ont pas été oubliées : elles représenteraient 22,8 gigaoctets.