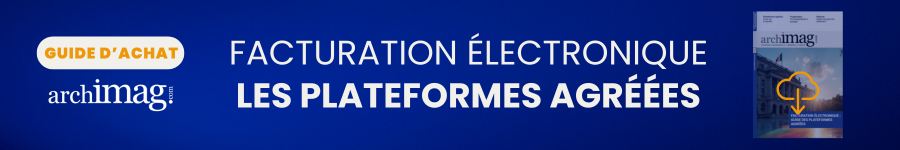Le rapport 2016 de l'Inspection générale des bibliothèques pointe les effets des restrictions budgétaires et les tensions liées aux questions religieuses.
Les bibliothèques, notamment les établissements de l'enseignement supérieur, ont payé un lourd tribut aux compressions budgétaires : suppression des abonnements aux périodiques et aux bases de données, révision à la baisse des acquisitions, relations tendues avec les éditeurs... Ce constat n'a pas échappé à l'Inspection générale des bibliothèques (IGB).
Son rapport pour l'année 2016 revient sur une situation critique : "dans l’enseignement supérieur, les dépenses documentaires des universités ont baissé en valeur absolue dans une période de croissance de la population étudiante. De 2011 et 2015, elles ont en effet diminué de 10% en moyenne (...) En ratio par étudiant, les dépenses documentaires des services communs de documentation ont baissé de 15% en cinq ans" souligne Pierre Carbone, Doyen de l'Inspection générale des bibliothèques.
Principales victimes de ces restrictions, les achats de livres imprimés puis les dépenses de niveau formation qui représentent un tiers du total. Le cas de la bibliothèque interuniversitaire Santé rattachée à l'Université Paris Descartes a eu un certain écho en raison des suppressions massives d'abonnements de périodiques et de bases de données : "elle ne pourra trouver un cadre de fonctionnement durable qu’à travers une clarification de ses missions et de son statut" estime l'IGB.
Transition numérique et laïcité
Du côté des bibliothèques de lecture publique, l'IGB souligne "les progrès de l'intercommunalité". Les exemples de Dole (Jura), d'Alençon (Orne), de Bayeux (Calvados) ou La Roche-sur-Yon témoignent de l'intérêt du regroupement de communes.
Quant à la transition numérique des bibliothèques, elle se poursuit grâce au programme Bibliothèques numériques de référence (BNR) qui a bénéficié d'une enveloppe budgétaire de l'Etat de 9,57 millions d'euros entre 2010 et 2015. "La transition numérique contribue ainsi à renforcer et approfondir les missions essentielles des bibliothèques" constate l'IGB.
Plus préoccupante, la question de la laïcité s'invite également dans les bibliothèques. Des tensions liées aux questions religieuses ont été signalées dans plusieurs établissements. L'Inspection générale des bibliothèques rappelle quelques principes : "le pluralisme des collections et la neutralité de l'institution impliquent qu'elles offrent des documents concernant non seulement les religions dans leur diversité, mai aussi les convictions spirituelles non religieuses ou critiques (athéisme, agnosticisme...)"