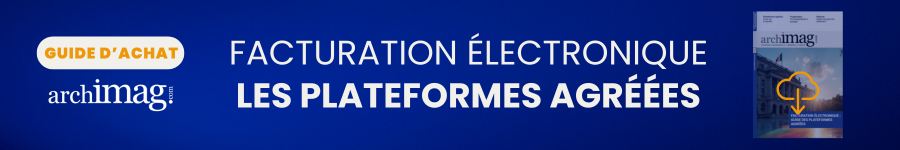Quels effets les technologies ont-elles eu sur notre accès à l'information ?
Quand les fameuses « autoroutes de l’information » sont apparues au début des années 2000, nous avons d’abord bénéficié d’une augmentation de nos connaissances grâce notamment à la multiplication des sites et à l’accélération de la transmission de l’information. Pourtant, cette ouverture est en train de se refermer.
>Lire aussi : La veille au défi des limites humaines et technologiques
Certes, nous avons accès à tout ce que nous voulons, mais nos compétences pour y accéder et notre temps restent limités. Les algorithmes, développés pour nous mâcher le travail, ont réduit la variété des résultats. Finalement, près de 90 % des gens ne vont pas au-delà de la première page de Google et tout ce qui est disponible reste inaccessible. Notre horizon informationnel se rétrécit.
Les réseaux sociaux constituent un autre mode d’accès à l’information, controversé, mais néanmoins très important : eux fonctionnent avec des algorithmes de recommandation qui nous enferment dans des bulles de filtres, c’est-à-dire dans les recherches et les partages de nos amis et dans ce que nous-mêmes aimons et consommons déjà.
>Lire aussi : Internet nous enferme-t-il dans une bulle ?
Et en quoi le mobile a-t-il transformé notre façon de nous informer ?
Les smartphones ont accentué le phénomène de diffusion de l’information en temps réel et les notifications nous mettent dans une position de passivité. Ce phénomène attaque notre disponibilité mentale qui se réduit à ce qui est chaud et réactif — à l’inverse de ce qui favorise la prise de recul.
Comment s’en prémunir ?
Le niveau d’instruction, le recul porté sur l’information chaude, la contextualisation ou la recherche de sources complémentaires devraient être enseignés par l’institution scolaire.
>Lire aussi : Netguide : libérez-vous des médias sociaux avec une page d'accueil et un moteur de recherche éthiques
Par ailleurs, je m’interroge sur la façon de mettre à disposition du plus grand nombre des outils alternatifs simples qui permettraient d’aller chercher la fameuse sérendipité. Cela pourrait aussi passer par des algorithmes paramétrés différemment, avec une notion d’aléatoire et d’ouverture.