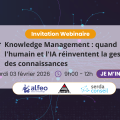Une étude canadienne dénonce les pertes engendrées par de mauvaises pratiques archivistiques.
Chaque année, des centaines d'articles scientifiques sont publiés dans les domaines de la physique et de la biologie. Malheureusement, une partie de cette production se perd en raison de mauvaises pratiques archivistiques. La durée de vie moyenne des données scientifiques ne dépasserait pas vingt ans selon une étude réalisée par l'université de Colombie britannique (Canada).
"Ces données constituent la colonne vertébrale des études scientifiques mais elles sont de moins en moins accessibles aux chercheurs au fil du temps" soulignent les auteurs de l'étude. Après avoir tenté de collecter 516 articles publiés entre 1991 et 2011, les chercheurs ont estimé que les chances de retrouver un article diminue de 17 % deux ans après sa publication. En cause, des pratiques d'archivage obsolètes et des moyens d'accès aux documents inefficaces.
Les auteurs de l'étude incitent donc les chercheurs à "prendre une part plus active à la préservation des données". Ils préconisent également de changer les pratiques actuelles d'archivage et demandent aux bibliothèques universitaires de conduire ce changement.