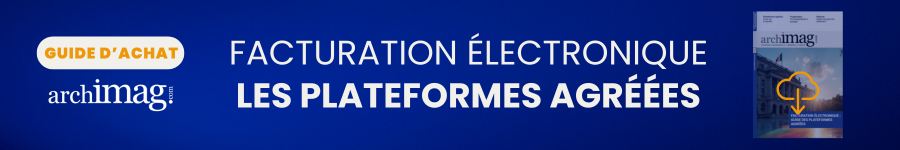Il faut agir selon trois axes :
1 - Zéro papier : Viser le zéro papier est un geste fort en faveur de la nature : on évite de couper des arbres absorbeurs de CO2, de faire tourner des usines consommant beaucoup d’eau, d’énergie et de produits chimiques, avec la logistique que cela suppose (transport). Réduire l’usage du papier se traduit aussi en économies (sur le coût du papier, ses espaces de stockage). De quoi encourager la numérisation des documents papier (on peut détruire les originaux, les recycler) et l’adoption d’un numérique natif.
2 - Hébergement responsable : Un serveur, que ce soit dans un data center ou une organisation, consomme de l’électricité et a besoin d’être refroidi. Ici, les gestes responsables sont :
- occuper un bâtiment écoresponsable ;
- recourir à une électricité verte ;
- tirer le meilleur parti du stockage sur les serveurs : ne stocker que ce qui doit l’être. C’est ce qu’opère normalement une GED, qui plus est couplée avec un système d’archivage électronique (SAE). Stockage et archivage sont optimisés grâce à la gestion du cycle de vie de l’information ; celui-ci détermine le sort final, destruction (donc économie de place sur les serveurs et d’énergie) ou conservation (versions compressées dans un espace à accès restreint et moins sollicité, donc moins vorace en énergie).
3 - Usages responsables : Une GED rend l’information mieux accessible : les temps de recherche sont moindres et donc plus économes en énergie. Un document n’a pas de doublon, il ne circule pas en pièce jointe dans un mail, c’est un lien qui peut être transmis. Surtout, les utilisateurs y accèdent et le traitent directement dans la GED, ce qui évite tout échange énergivore. On évite les ruptures dans la chaîne numérique. En particulier, on n’imprime pas un document pour le signer (économie de papier, de consommables, d’énergie...), le processus peut très bien inclure une signature électronique. La diffusion peut elle aussi rester numérique.
Le bilan carbone de l’organisation dépend largement de ses modes de fonctionnement - la GED favorise les comportements vertueux -, mais aussi de ces fournisseurs. Il convient de choisir ses fournisseurs de GED en ajoutant des critères d’écoresponsabilité :
- engagement éthique en faveur de l’humain et de la planète ;
- publication du bilan carbone incluant la dématérialisation (par exemple avec l’appui du « Référentiel de la dématérialisation écoresponsable » réalisé par Serda Conseil et Coopérative Carbone) ;
- recours à une énergie verte ;
- démarche d’écoconception (économie circulaire, open source...) évitant notamment les mises à jour à répétition d’un logiciel provoquant l’obsolescence d’un matériel pourtant relativement durable.
Cela peut se traduire par l’adoption d’une démarche de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), éventuellement avec la notation Ecovadis, le respect des normes Iso 14001 (management environnemental), Iso 50001 (performance énergétique), la signature, concernant un hébergeur, du Code de conduite européen des centres de données (EU CoC for Data Centres), etc. Les éditeurs qui cochent le plus de cases gagnent leur place en short list !