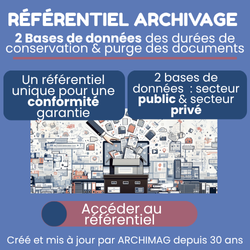CET ARTICLE A INITIALEMENT ÉTÉ PUBLIÉ DANS ARCHIMAG N°387 - CYCLE DE VIE DE LA DATA : L’AFFAIRE DE TOUS !
CET ARTICLE A INITIALEMENT ÉTÉ PUBLIÉ DANS ARCHIMAG N°387 - CYCLE DE VIE DE LA DATA : L’AFFAIRE DE TOUS !
 Découvrez L'Archiviste Augmenté, la newsletter thématique gratuite d'Archimag dédiée aux professionnels des archives et du patrimoine !
Découvrez L'Archiviste Augmenté, la newsletter thématique gratuite d'Archimag dédiée aux professionnels des archives et du patrimoine !
Depuis plus de trois décennies, les archivistes naviguent entre des normes juxtaposées, conçues à l’ère du papier, difficilement interopérables et trop cloisonnées. Sans renier cet héritage, les archives papier et numériques trouvent aujourd’hui un nouveau souffle avec Records in Contexts (Archives en Contextes ou RiC), une norme unifiée et évolutive, dont le périmètre concerne tout type d’archives, analogiques ou numériques. Pensée pour répondre aux défis du numérique, elle entend offrir aux professionnels des archives une grammaire commune, adaptée aux complexités contemporaines du métier.
Réécrire les règles du jeu archivistique
 Le paysage normatif de la description archivistique repose depuis les années 1990-2000 sur un empilement de normes internationales - ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDF et ISDIAH - complémentaires, mais séparées, chacune avec ses propres entités et règles, sans véritable articulation ni modèle global unifié. Conçues pour l’archivage papier, elles sont difficilement adaptables au web sémantique. Louis Vignaud, chargé de la politique nationale sur les métadonnées et référentiels archivistiques au Service interministériel des Archives de France (Siaf), précise que "le manque d’articulation entre les normes conduit à des frictions, comme sur la description des producteurs d’archives, partiellement redondante entre ISAD(G) et ISAAR-CPF".
Le paysage normatif de la description archivistique repose depuis les années 1990-2000 sur un empilement de normes internationales - ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDF et ISDIAH - complémentaires, mais séparées, chacune avec ses propres entités et règles, sans véritable articulation ni modèle global unifié. Conçues pour l’archivage papier, elles sont difficilement adaptables au web sémantique. Louis Vignaud, chargé de la politique nationale sur les métadonnées et référentiels archivistiques au Service interministériel des Archives de France (Siaf), précise que "le manque d’articulation entre les normes conduit à des frictions, comme sur la description des producteurs d’archives, partiellement redondante entre ISAD(G) et ISAAR-CPF".
C’est ce manque de cohérence qui a poussé le Conseil international des archives (ICA) à lancer en 2012 le projet RiC sous l’égide du groupe d’experts sur la description archivistique (Egad). L’objectif : créer un standard unique, capable de refléter les réalités complexes de la production, de la conservation et de la description des archives à l’ère numérique.
La genèse de RiC suit un processus lent, mais rigoureux. Après une première version en 2016 et de nombreux retours de la communauté, la version 1.0 des trois premières parties du standard a été publiée en décembre 2023. Environ vingt experts internationaux, tous bénévoles, y ont contribué. "Chaque mot a été pesé", souligne Florence Clavaud, responsable du Lab aux Archives nationales de France, membre exécutif du groupe ICA/Egad et responsable de l’équipe de développement de RiC-O. "Définir des concepts, comme "l’entité Record Resource" ou "Instantiation", de façon compréhensible à l’échelle internationale, a demandé des mois de débats".
Lire aussi : Archiver les données : une opportunité de collaboration entre archivistes et informaticiens
L'architecture de RiC : CM, O, FAD, AG
La norme RiC est composée de quatre parties complémentaires :
- RiC-FAD (Foundations of Archival Description) : introduction aux principes fondamentaux de la description archivistique, les périmètres et les objectifs de la norme,
- RiC-CM (Conceptual Model) : c’est le socle théorique de la norme. Il définit une vue théorique des entités et de leurs relations dans le domaine archivistique à travers un modèle entités-relations. Il identifie notamment 19 types d’entités, 42 attributs et 85 relations,
- RiC-O (Ontology) : il s’agit d’une transposition technique de RiC-CM, permettant de produire des graphes de données interopérables, prêts à être publiés dans le web sémantique. Grâce à RiC-O, les relations entre entités archivistiques peuvent être modélisées sous forme de triplets (sujet - prédicat - objet), conformément au langage Resource description framework (RDF),
- RiC-AG (Application Guidelines) : cette future partie de RiC, dont la première version sera publiée fin 2025, prendra la forme d’un guide de bonnes pratiques et d’exemples nourri par les retours d’expérience.
L’approche entités-relations
 À l’instar de la norme IFLA-LRM, mise en œuvre dans le catalogage de la transition bibliographique, la capacité de RiC à être interrogé aussi bien par les humains que par les ordinateurs s’appuie sur l’un de ses grands atouts : la mutualisation des entités descriptives, notamment "les agents (personnes ou institutions) ou les lieux", souligne Jan Krause-Bilvin, archiviste informaticien chez docuteam et membre d’Ica/Egad. Manonmani Restif, cheffe de projet du portail FranceArchives, explique : "il suffit, par exemple, que les Archives nationales décrivent leur fonds d’archives de Georges Clemenceau pour que tous les autres services d’archives puissent réutiliser ces données".
À l’instar de la norme IFLA-LRM, mise en œuvre dans le catalogage de la transition bibliographique, la capacité de RiC à être interrogé aussi bien par les humains que par les ordinateurs s’appuie sur l’un de ses grands atouts : la mutualisation des entités descriptives, notamment "les agents (personnes ou institutions) ou les lieux", souligne Jan Krause-Bilvin, archiviste informaticien chez docuteam et membre d’Ica/Egad. Manonmani Restif, cheffe de projet du portail FranceArchives, explique : "il suffit, par exemple, que les Archives nationales décrivent leur fonds d’archives de Georges Clemenceau pour que tous les autres services d’archives puissent réutiliser ces données".
RiC autorise aussi une description plus fine, notamment la généalogie des producteurs ou l’historique d’un fonds. Il introduit la réversibilité des relations : "si Georges Clemenceau est lié à son fils par une relation "père de", la notice du fils renverra à une relation inverse "fils de" vers le père", ajoute Manonmani Restif.
Lire aussi : Transition bibliographique : après dix ans de chantier, quel bilan aujourd’hui ?
Une norme en quête d’adoption
Selon Anne-Solène Daniel, ancienne documentaliste et consultante chez Serda Conseil, la norme RiC ne fait pas encore grand bruit en France : "malgré la publication de RiC 1.0, peu d’éditeurs l’ont intégrée dans les outils métiers". "Pourtant, son application permettrait aux archivistes de mieux dialoguer avec les développeurs, voire de créer un "langage commun" pour favoriser l’interopérabilité entre systèmes et enfin sortir du paradigme rigide des plans de classement", précise-t-elle.
Pour le moment, la conduite de projets pilotes autour de RiC concerne quelques institutions françaises. Le portail FranceArchives a pu en faire l’expérience avec l’entrepôt SPARQL, ouvert en 2023, qui est, actuellement, selon Manonmani Restif, "le plus gros réservoir de métadonnées archivistiques en RDF conforme à RiC-O 0.2, avec 504 millions de triplets créés à partir de 101 000 instruments de recherche". L’objectif est d’exposer des données enrichies en utilisant des référentiels externes et de les lier à d’autres réservoirs, comme data.bnf.fr. Un outil de requêtes SPARQL classique permet d’interroger l’ensemble du réservoir RDF de FranceArchives.
Les Archives nationales (AN) figurent parmi les pionnières de l’expérimentation de la norme RiC en France, notamment à travers le projet PIAAF (2014–2018), que Florence Clavaud décrit comme "une démonstration de la faisabilité et de l’intérêt de la sémantisation des métadonnées selon RiC-O". Conçu avec l’éditeur de logiciels Logilab, le Siaf et la Bibliothèque nationale de France (BnF), ce prototype a permis de convertir des fichiers EAD et EAC-CPF en RDF, tout en préservant leur richesse descriptive. Dans le prolongement de cette preuve de concept, les AN ont conçu RiC-O Converter, un outil open source capable de traiter massivement les instruments de recherche et notices d’autorité.
 En Suisse, l’adoption de RiC bénéficie d’un terrain favorable, porté par une organisation fédérale qui repose sur "l’engagement des institutions elles-mêmes", explique Jan Krause-Bilvin. Dès 2019, l’Association des archivistes suisses a même lancé un groupe de travail dédié. De son côté, l’entreprise docuteam a entièrement réécrit ses outils pour les aligner sur RiC, répondant à une demande croissante de ses clients.
En Suisse, l’adoption de RiC bénéficie d’un terrain favorable, porté par une organisation fédérale qui repose sur "l’engagement des institutions elles-mêmes", explique Jan Krause-Bilvin. Dès 2019, l’Association des archivistes suisses a même lancé un groupe de travail dédié. De son côté, l’entreprise docuteam a entièrement réécrit ses outils pour les aligner sur RiC, répondant à une demande croissante de ses clients.
Lire aussi : Publication de la norme européenne CEN/TS 18170 sur les services d'archivage électronique
Défis d’appropriation
Malgré la difficulté à traduire en français "un sujet déjà compliqué", comme le souligne Louis Vignaud, le travail continue : la traduction française de RiC-FAD est en cours, menée par un groupe d’archivistes volontaires francophones, tandis que l’Egad poursuit l’évolution de RiC-AG et RiC-O. L’adoption de RiC se heurte également à un besoin important de formation et de vulgarisation. Le sujet exige un accompagnement reposant à la fois sur des ressources détaillées, telles que celles disponibles sur la page informelle tenue par l’Egad, et sur une communauté engagée, réunie notamment dans un groupe d’échange Google, qui sont essentielles à la dynamique et à l’évolution de la norme.
Dans un futur plus ou moins proche, RiC pourrait s’avérer pertinent dans des secteurs techniques ou industriels à fortes exigences documentaires, "comme le nucléaire, l’aéronautique ou les infrastructures sensibles", souligne Anne-Solène Daniel, pour qui la force de cette norme est de répondre à un besoin de convergence documentaire.
Les perspectives d’évolution de RiC sont nombreuses, puisque la norme continuera de s’améliorer grâce aux retours d’expérience des projets d’implémentation. De plus, elle pourrait s’articuler avec d’autres standards, comme PREMIS (PREservation Metadata Implementation Strategies), le standard international utilisé par la BnF pour les métadonnées de préservation des ressources numériques, afin d’offrir un cadre global pour l’ensemble du cycle de vie des archives.