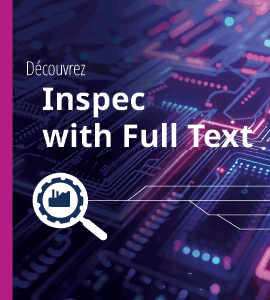Temps de lecture : 7 minutes
Certains de vos livres sont documentés à partir d’archives notamment des archives judiciaires. À quel moment êtes-vous devenu un usager régulier des services d’archives ?
Je suis quelqu’un d’assez timide et les services d’archives m’ont toujours paru réservés aux chercheurs, aux universitaires et aux généalogistes. J’éprouvais d’ailleurs le même sentiment devant les bibliothèques.
La toute première fois que je suis entré dans un service d’archives remonte à 2014 alors que je recherchais de la documentation pour mon roman « La Petite femelle » (2015) qui relate la vie de Pauline Dubuisson jugée en 1953 à Paris pour le meurtre de son ex-petit ami Félix Bailly. Dans un premier temps, j’avais acheté de nombreux livres et journaux anciens consacrés à cette affaire, mais je me suis rapidement rendu compte que cette production était contradictoire. Cette histoire a donné lieu à un tel pathos que les journalistes ont écrit ce qu’ils voulaient. Je me suis alors dit : « Prends-toi en main mon bonhomme et entre dans une salle d’archives ». Mais j’étais intimidé au point de demander à mon éditeur Julliard de bien vouloir m’écrire une lettre certifiant que j’écrivais un livre sur ce sujet.
Je me suis donc rendu aux Archives de Paris comme un gamin le jour de la rentrée des classes. Je ne connaissais rien au monde des archives et j’ai alors découvert un dossier de plusieurs centaines de pages constitué de lettres manuscrites, de photographies… Je dois d’ailleurs dire que les Archives nationales et certaines des Archives départementales sont très bien organisées en permettant de réserver des documents en ligne avant d’aller les consulter.
 Lire aussi : Irène Frain : "Je souhaite que la France soit plus active dans la préservation de ses archives"
Lire aussi : Irène Frain : "Je souhaite que la France soit plus active dans la préservation de ses archives"
Dans « La Serpe », vous notez que les archivistes sont des « inestimables alliés ». En quoi leur travail peut-il aider l’écrivain ?
Alors que je craignais de déranger les archivistes, je me suis rendu compte, au contraire, qu’ils prenaient très à cœur leur mission de communication de documents aux lecteurs. Pour mon roman « La Serpe », je me suis adressé aux Archives départementales de Dordogne qui se sont mises en quatre pour me communiquer les documents dont j’avais besoin.
En fréquentant les services d’archives, j’ai découvert, à cinquante ans passés, un monde qui me touche profondément. Depuis, j’ai eu l’occasion de participer à de nombreuses rencontres dans les salles d’archives à Paris et en province pour raconter ma propre expérience des archives. Si je n’avais pas été écrivain, j’aurais aimé être archiviste…
 Lire aussi : Alberto Manguel fait don de sa bibliothèque de 40 000 livres à la ville de Lisbonne
Lire aussi : Alberto Manguel fait don de sa bibliothèque de 40 000 livres à la ville de Lisbonne
Outre les archives, quelles ressources documentaires utilisez-vous ?
Pour le roman « Sulak » qui raconte l’histoire de Bruno Sulak, un célèbre braqueur des années 1980, j’ai eu recours à la presse de l’époque, ainsi qu’à des témoignages directs recueillis auprès de son entourage. Pour « La Petite femelle » et « La serpe », les archives sont devenues ma base documentaire principale : dossiers d’instruction, enquêtes de la police judiciaire, dossiers de l’administration pénitentiaire… Ces sources archivistiques de première main donnent à réfléchir sur l’écart qui existe avec ce qu’en dit parfois la presse.
J’utilise également beaucoup Gallica. Aussi bien pour mes deux romans précédents (« La Petite femelle » et « La serpe ») que pour le prochain, les archives de la presse numérisées sur Gallica m’ont été extrêmement précieuses. Notamment pour tous les passages concernant ce qui est antérieur aux années 1960. Une mine d’or, vraiment, l’expression n’est pas galvaudée dans ce cas-là. J’y ai même trouvé l’information qui change tout dans mon prochain livre, ce que personne n’avait jamais trouvé, et que je n’aurais pu trouver, c’est certain, nulle part ailleurs. J’y ai passé des heures et des heures, c’est un outil formidable, et pour moi indispensable.
 Lire aussi : Milan Kundera lègue ses livres et ses archives à la bibliothèque de Brno
Lire aussi : Milan Kundera lègue ses livres et ses archives à la bibliothèque de Brno
Vous avez une méthode très particulière pour exploiter votre documentation. Pouvez-vous nous en parler ?
Ma technique consiste à lire et à enregistrer sur un dictaphone toute la documentation que je rassemble : articles de presse, archives, extraits de livres, dépositions… Pour mon prochain roman, je dispose déjà de plusieurs milliers d’heures d’enregistrement soit 7 000 fichiers sons !
Cette phase de lecture et d’enregistrement m’a pris un an et demi. Une fois que j’ai tout lu, je réécoute et j’écris mot pour mot l’intégralité de ce que j’ai enregistré. Cela me prend des mois, mais c’est une façon de m’imprégner des pièces du dossier. Au final, je me retrouve avec un fichier de 1 300 pages rédigées à partir de cette documentation. C’est seulement à partir de ce moment-là que je commence à écrire mon livre…
 Lire aussi : François Mauriac : l'histoire d’un presque archiviste devenu écrivain
Lire aussi : François Mauriac : l'histoire d’un presque archiviste devenu écrivain
Comment faites-vous pour ne pas vous noyer dans cette masse documentaire ?
C’est un problème en effet ! Le livre que je suis en train d’écrire m’occupe sept jours sur sept et j’y passe l’essentiel de mes journées.
Je n’ai quasiment pas pris de vacances depuis trois ans pour me consacrer à mon prochain livre. Avec tous les détails que j’ai accumulés, je vais voir si j’arrive à ne pas me noyer… En comparaison, mes livres précédents étaient des historiettes toutes simples !
 Lire aussi : L'écrivain Haruki Murakami confie ses archives et sa discothèque à la recherche
Lire aussi : L'écrivain Haruki Murakami confie ses archives et sa discothèque à la recherche
Avez-vous trouvé le point d’équilibre entre la vérité telle qu’elle est établie par les archives et la liberté du romancier ?
Je m’accorde une liberté et une seule : dire ce que je pense. En revanche, je ne change jamais un détail de ce que je trouve dans les archives. Mon but n’est pas de recopier un dossier d’instruction, mais de voir les failles, les erreurs ou les mensonges qu’on y trouve.
Fréquentez-vous les bibliothèques autant que les services d’archives ?
Non, car je n’y suis pas très à l’aise et parce que je n’en ai pas vraiment besoin. Je me suis tout de même récemment rendu à la bibliothèque Sainte-Geneviève pour y consulter les microfilms du journal Libération [journal lancé par le mouvement de résistance Libération-Sud entre 1941 et 1964, NDLR] car je ne les ai pas trouvés sur le web.
Encore maintenant, j’ai la trouille d’aller dans les belles bibliothèques comme si j’étais un adolescent débarquant à Paris !
 Lire aussi : René Girard, un philosophe passé par la case "Archives"
Lire aussi : René Girard, un philosophe passé par la case "Archives"
Avez-vous mis en place des outils documentaires particuliers du type flux RSS, site de partage de signets ou réseaux sociaux ?
Je me sers énormément d’internet, mais de manière très pragmatique : pour effectuer des recherches, pour acheter des journaux et des livres, pour entrer en contact avec des personnes… En revanche, j’ai quasiment quitté les réseaux sociaux car ce n’est pas sur Twitter ou Instagram que je vais trouver l’information utile pour l’écriture de mes livres.
Avez-vous l’intention, un jour, de léguer votre propre documentation à un service d’archives ou au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France ?
Je n’aurais pas la prétention de léguer quoi que ce soit à la Bibliothèque nationale de France. Plus jeune, je conservais mes textes imprimés sur des feuilles volantes, mais j’ai fini par les jeter à la poubelle. Je me sers d’archives, mais je n’en laisse pas, ça n’est pas très fair-play, je reconnais !
Il se trouve que mes livres sont écrits au format numérique avec un traitement de texte. Et ma mécanique d’écriture est un peu particulière : plutôt que d’écrire de façon linéaire, j’ai opté pour une « écriture en rouleaux » qui me permet d’écrire quelques phrases et de revenir dessus afin de trouver l’équilibre qui me convient entre les paragraphes.
 Lire aussi : Plongez dans les 4 450 lettres numérisées de Gustave Flaubert !
Lire aussi : Plongez dans les 4 450 lettres numérisées de Gustave Flaubert !
Il y a vingt-cinq ans, lorsque j’ai écrit mon premier roman, j’étais en mesure d’écrire dix pages par jour. Aujourd’hui, je n’en écris plus que trois ou quatre alors que je travaille plus longtemps.
Il y a tout de même un avantage à cela : il n’y a pas beaucoup de modifications à apporter à ce que j’ai écrit. Une fois le texte terminé, je l’imprime et le relis pour effectuer au stylo quelques petites corrections. C’est le seul document que je pourrais éventuellement léguer au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France.ok