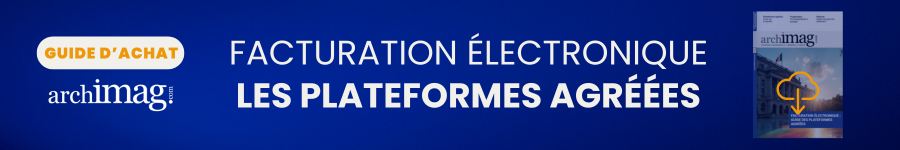Découvrez Le Bibliothécaire Innovant, la newsletter thématique gratuite d'Archimag dédiée aux professionnels des bibliothèques et de la conservation !
Découvrez Le Bibliothécaire Innovant, la newsletter thématique gratuite d'Archimag dédiée aux professionnels des bibliothèques et de la conservation !
 Depuis une trentaine d’années, on assiste à un mouvement croissant de dématérialisation de la documentation au sein des bibliothèques. Dans les bibliothèques académiques, cette tendance a d’abord concerné les périodiques, puis un peu plus tardivement, les monographies, par le biais d’achats pérennes ou de souscription à des bouquets - de telle sorte que de nos jours, le livre numérique est devenu une ressource très largement répandue dans ce type d’établissement.
Depuis une trentaine d’années, on assiste à un mouvement croissant de dématérialisation de la documentation au sein des bibliothèques. Dans les bibliothèques académiques, cette tendance a d’abord concerné les périodiques, puis un peu plus tardivement, les monographies, par le biais d’achats pérennes ou de souscription à des bouquets - de telle sorte que de nos jours, le livre numérique est devenu une ressource très largement répandue dans ce type d’établissement.
Par ailleurs, il y a encore une dizaine d’années, le livre numérique était encore considéré comme un produit émergent et faisait donc rarement l’objet d’une politique documentaire dédiée. Les collections imprimées et numériques de monographies tendaient ainsi à faire l’objet d’un développement et d’une gestion parallèles, souvent par des services distincts.
Lire aussi : Les espaces des bibliothèques s'adaptent aux pratiques des usagers
Depuis, l’offre de livres numériques à destination d’un public académique s’est considérablement recomposée. D’une part, l’offre commerciale, jusque-là majoritairement anglophone et de niveau "recherche", s’est diversifiée : en France, on a ainsi vu se développer une offre francophone, s’étendant par ailleurs au niveau "formation".
D’autre part, l’essor des publications en accès ouvert ainsi que la politique d’acquisition en licences nationales ont aussi considérablement élargi le nombre de monographies numériques accessibles au lectorat des bibliothèques.
Une vision "multisupport" de la politique documentaire
Par ailleurs, l’hybridation croissante de la documentation entre supports imprimé et numérique a favorisé l’essor d’une vision "multisupport" de la politique documentaire dans les bibliothèques, c’est-à-dire d’un développement et d’une gestion articulés et concertés des ressources imprimées et numériques, à rebours de la tendance évoquée précédemment.
L’enquête menée, dans le cadre de ce mémoire, auprès d’une trentaine de bibliothèques académiques françaises a permis de constater que si un certain nombre d’établissements pratiquent déjà ou souhaitent tendre vers une telle conception de la politique documentaire, l’intégration des livres numériques dans les collections n’est cependant pas sans poser un certain nombre de difficultés.
Lire aussi : Détecter les contenus créés par une IA : il y a un label pour ça !
Parmi ces dernières, on peut par exemple mentionner le caractère désormais pléthorique de l’offre de livres numériques (qui ne recoupe néanmoins pas exactement celle de livres imprimés) ; la complexité technique et juridique de certains modèles d’accès aux monographies numériques ainsi que le coût de la documentation numérique en regard de celle sur support imprimé.
Enfin, la difficulté à appréhender les usages effectifs des livres numériques par les lecteurs des bibliothèques rend difficiles le pilotage et l’évaluation de sa politique documentaire.
Arbitrage entre version imprimée ou numérique des monographies
Face à ces obstacles, les leviers mis en œuvre par les bibliothèques académiques peuvent être de différente nature. D’une part, intégrer le livre numérique à une politique documentaire suppose une réflexion organisationnelle.
Certains établissements ont par exemple choisi de confier tout ou partie de la sélection des livres numériques à des acquéreurs disciplinaires dont le périmètre d’activité se cantonnait jusque-là aux seules monographies imprimées - un type de démarche qui recèle de forts enjeux de formation et d’accompagnement au changement.
Lire aussi : Dossier - Bibliothèques : quels enjeux en 2023 ?
D’autre part, mener une politique documentaire du livre numérique suppose de mettre en œuvre des outils, méthodes et procédures ad hoc. Les enquêtes locales sur les besoins et usages effectifs des publics peuvent ainsi aider à déterminer jusqu’à quel point il est souhaitable de développer les monographies numériques au sein d’un établissement donné, de même que la formalisation de critères clairs de doublonnage ou d’arbitrage entre version imprimée ou numérique des monographies dans des plans de développement des collections ou des fiches-domaines multisupport aident à la rationalisation des collections.
Enfin, une politique documentaire du livre numérique est indissociable d’une véritable stratégie de médiation, allant du signalement à la formation des usagers, en passant par la valorisation, qu’elle soit numérique ou dans les espaces des bibliothèques.
Mathilde Gourret
[Responsable du Département des données des bibliothèques de l’École normale supérieure]