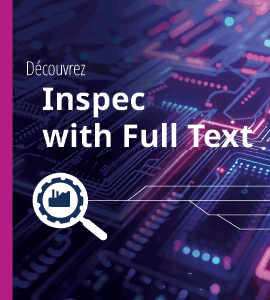Temps de lecture : 8 minutes
 Découvrez toutes les newsletters thématiques d'Archimag : 4 newsletters gratuites mensuelles dédiées aux professionnels des bibliothèques, des archives, de la veille et de la documentation, et enfin de la dématérialisation et de la transformation digitale.
Découvrez toutes les newsletters thématiques d'Archimag : 4 newsletters gratuites mensuelles dédiées aux professionnels des bibliothèques, des archives, de la veille et de la documentation, et enfin de la dématérialisation et de la transformation digitale.
Le droit d’auteur sur les œuvres dérivées
Le droit d’auteur qualifie ce type d’œuvre de dérivée : il s’agit d’œuvres qui dérivent d’une œuvre originaire. Le Code de la propriété intellectuelle reconnaît ainsi quatre types d’œuvres dérivées, dont la traduction (ainsi que l’adaptation, la transformation et l’arrangement, articles L.112-3 et L.122-4 CPI).
Ceci précisé, la question peut se poser de savoir dans quelle mesure un traducteur fait œuvre d’auteur puisqu’il se borne à traduire le plus fidèlement possible l’œuvre d’un autre auteur. Le spectre de l’originalité de l’œuvre, ndition de sa protection, fait alors son apparition… avec en contrepoint, l’adage « traduction, trahison ». Et pourtant, il y a une qualité dans une traduction qui fait qu’on peut préférer telle ou telle traduction des classiques étrangers pour leur beauté intrinsèque, preuve qu’il peut y avoir des traductions différentes d’une même œuvre, donc inévitablement un apport personnel propre à chaque traducteur.
Pour clore cette introduction, citons Jean-René Ladmiral, traducteur et traductologue réputé qui pose tout le dilemme d’une traduction :
« À quoi, à qui, une traduction doit-elle être fidèle ? À la langue source ou à l’esprit de ce qu’il faudra rendre dans la langue cible ? Il y a là une antinomie entre deux modes de fidélités possibles. Toute traduction existe dans la tension entre ces deux exigences, nécessaires et contradictoires qui la définissent ». (« Sourcier ou cibliste : les profondeurs de la traduction », Les Belles Lettres, 2014).
 Lire aussi : Originalité de l'oeuvre : tout savoir sur cette notion du droit d’auteur
Lire aussi : Originalité de l'oeuvre : tout savoir sur cette notion du droit d’auteur
Le régime juridique de la traduction : deux droits d’auteur en jeu
Bien entendu, le droit d’auteur du traducteur est tributaire des droits de l’auteur de l’œuvre d’origine, à un double niveau.
Traduction : une exploitation de l’œuvre
Pour les œuvres encore protégées par les droits d’exploitation de leur auteur, l’article L.122-4 précité pose le principe de l’autorisation de l’auteur pour effectuer une traduction.
Le traducteur — ou l’éditeur qui le mandate — doit donc avoir obtenu l’accord de l’auteur ou de ses ayants droit après sa mort, tant que l’œuvre n’est pas tombée dans le domaine public (en France, en Europe et dans de nombreux pays, délai de 70 années post mortem).
 Lire aussi : Comprendre le droit d'auteur : qui est "auteur" ?
Lire aussi : Comprendre le droit d'auteur : qui est "auteur" ?
Traduction et respect de l’intégrité de l’œuvre d’origine
Dans tous les cas de figure le droit moral existe sur l’œuvre d’origine. Mais en France et dans les autres pays où le droit moral survit bien au-delà du droit d’exploitation (en France le droit moral est perpétuel), le traducteur, n’ayant pas à demander d’autorisation pour traduire, doit cependant respecter ce droit moral de l’auteur sur son œuvre. Plus spécialement, la traduction ne peut dénaturer l’œuvre d’origine, par exemple en prenant de trop grandes libertés avec le sens de l’original.
Dans pareil cas, les ayants droit pourraient être fondés à contester la qualité de la traduction, jusqu’à s’opposer à sa publication.
 Lire aussi : Propriété intellectuelle : tout savoir sur le périmètre d'exploitation
Lire aussi : Propriété intellectuelle : tout savoir sur le périmètre d'exploitation
Le traducteur, auteur à part entière
Nous l’avons montré, étant donné qu’il ne peut y avoir deux traductions identiques émanant de deux traducteurs différents, il y a forcément un degré d’originalité qui permet de considérer le traducteur comme auteur à part entière.
Il s’ensuit que, lors de publications d’œuvres sous sa traduction, il peut exiger de voir mentionnés son nom et sa qualité de traducteur (droit à la paternité de l’œuvre, l’un des deux grands droits moraux, avec le droit à l’intégrité de l’œuvre), voire faire condamner pour contrefaçon l’éditeur qui aurait omis son nom.
 Lire aussi : Droit d'auteur : un salarié ou un agent public est-il propriétaire de son oeuvre ?
Lire aussi : Droit d'auteur : un salarié ou un agent public est-il propriétaire de son oeuvre ?
Apport intellectuel et personnel
La cour d’appel de Paris a ainsi rappelé le 6 février 2002 que « des traductions de textes préexistants peuvent être protégées comme des œuvres originales, même si elles portent sur des archives étrangères accessibles au public, dès lors que ces traductions portent la marque de l’apport intellectuel et personnel de leur auteur notamment par le choix des mots et la construction des phrases utilisées pour exprimer en français le sens des textes étudiés ».
Le TGI de Paris, dans un jugement du 16 septembre 2016 a considéré qu’une traductrice travaillant pour le Reader’s Digest pouvait s’opposer à la republication sans son accord de ses traductions sur des supports non prévus dans son contrat de traductrice. On lui reconnaissait donc le droit de contrôler le périmètre d’exploitation de ses œuvres, comme à tout auteur.
 Lire aussi : L'autoédition, planche de salut pour les auteurs ?
Lire aussi : L'autoédition, planche de salut pour les auteurs ?
Quid des traductions pauvres en apport personnel ?
Si pour les œuvres littéraires, au sens plein du terme, l’apport original du traducteur n’est pas contestable, il en va autrement pour des œuvres scientifiques ou techniques. Dans ces derniers cas, l’impératif n’est pas de faire du style, un style propre à la langue de traduction pour rendre compte de la richesse du style de l’œuvre originale, il s’agit surtout de coller au plus près au discours scientifique ou technique et de ne dénaturer en aucun cas ce discours et ce transfert de connaissances.
Risquons cette analyse : en pareil cas, le but recherché est de faire passer de l’information, du sens scientifique ou technique, et non un émoi littéraire. C’est dès lors sur ce terrain que pourraient se trouver battues en brèche les prétentions à l’originalité d’un traducteur scientifique ou technique.
 Lire aussi : Quel avenir pour le droit d'auteur à l'ère numérique ?
Lire aussi : Quel avenir pour le droit d'auteur à l'ère numérique ?
Effort créatif ou démarche subjective
La jurisprudence évolue depuis quelques années sur le seuil d’originalité acceptable pour qu’une création soit reconnue comme protégée par le droit d’auteur. On l’a déjà vu à propos des photographies (Voir notre article : Droit d'auteur : une photographie est-elle toujours une œuvre originale ?).
Une récente décision de la cour d’appel de Paris, confirmant un jugement du TGI de Paris du 1er décembre 2017, a tranché ainsi :
« S’il apparaît, en l’espèce, que M. B. a procédé, dans son travail de traduction, à de multiples choix lexicaux, grammaticaux, documentaires et stylistiques, ce qui est attendu de tout traducteur, les choix qu’il revendique relèvent d’un savoir-faire (ainsi, typiquement, les “choix lexicaux ponctuels singuliers” décrits supra) et témoignent de son érudition (“prise en compte de l’histoire littéraire”) et de sa parfaite connaissance du sujet traité, sans pour autant être le signe d’un effort créatif ou d’une démarche subjective qui seraient révélateurs de l’empreinte de sa personnalité ».
On retrouve — toutes choses égales par ailleurs — la distinction entre le savoir technique du photographe réglant l’éclairage, la profondeur de champ, etc., et ses choix esthétiques, avec le même risque de tomber dans la prise en compte du mérite esthétique d’une œuvre pour la protéger comme œuvre d’auteur, ce qui est aux antipodes de la neutralité du droit d’auteur.
 Lire aussi : Comprendre le droit d’auteur : qu’est-ce qu’une oeuvre ?
Lire aussi : Comprendre le droit d’auteur : qu’est-ce qu’une oeuvre ?
Et les traductions automatiques ?
Le vieux rêve de l’humanité de faire faire son travail intellectuel par des robots est loin d’être complètement concrétisé… Dans le domaine qui nous concerne ici, il suffit de voir fonctionner un logiciel de traduction automatique sur des langues, certes européennes, mais dissemblables dans leurs structures grammaticales comme le français et l’allemand pour voir l’outil se vautrer dans les contresens les plus divertissants. Il ne s’agit en fait que de traduction assistée par ordinateur (TAO). Notons que l’exploitation de traductions automatiques suppose nécessairement l’accord des auteurs ainsi traduits.
Dernier écueil : les fautes de traductions peuvent avoir des incidences gravissimes dans certains domaines scientifiques, médicaux et juridiques, d’où la nécessité d’un expert (traducteur assermenté pour le droit) connaissant la matière dans les deux langues pour correctement post-éditer les textes ainsi produits. Bref, on n’en est pas encore à reconnaître un droit d’auteur à ces outils, pour le moment de simples aides techniques aussi utiles que risquées.
 Lire aussi : Comprendre le droit d'auteur : les cas de pluralités d'auteurs
Lire aussi : Comprendre le droit d'auteur : les cas de pluralités d'auteurs
Droit d'auteur et traduction : ce qu'il faut retenir
La traduction est une œuvre d’auteur, mais une œuvre dérivée d’une œuvre d’origine. Elle suppose l’accord de l’auteur à traduire, tant que son œuvre est protégée. L’œuvre ne pourra être dénaturée par une traduction par trop fantaisiste, au nom du droit à l’intégrité de l’œuvre, et même, dans beaucoup de pays, si elle est tombée dans le domaine public.
Repères juridiques
- Code de la propriété intellectuelle, articles L.112-3 (droit d’auteur sur les traductions) et L.122-4 (accord de l’auteur de l’œuvre d’origine pour autoriser sa traduction).
- CA Paris, 6 février 2002, sur Légifrance
- TGI Paris 16 septembre 2016, sur Legalis.net
- TGI Paris, 1er décembre 2017
- L’arrêt de la cour d’appel de Paris n’est pas disponible en ligne.
Didier Frochot
www.les-infostratèges.com